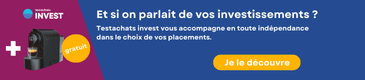Tout sur l'opération de la hernie de l'aine


Un homme sur quatre souffrira d'une hernie inguinale au cours de sa vie. Faut-il opérer ? Voici nos conseils.
Au début, la hernie est visible sporadiquement, puis en permanence. Souvent, le gonflement disparaît quand on est couché sur le dos. Normalement, on peut repousser le sac herniaire vers l'intérieur.
Signalons que, dans de rares cas, une hernie peut ne pas être visible et pourtant provoquer des plaintes. Le diagnostic est alors évidemment moins aisé.
L'évolution des hernies inguinales est imprévisible. Certaines grossissent progressivement, d'autres ne changent guère au fil du temps. Mais la hernie ne disparaît jamais d'elle-même. Le canal inguinal est également présent chez la femme, mais la zone de l'aine est moins faible que chez l'homme et les hernies sont donc beaucoup plus rares (risque estimé à 5%).
Un autre point faible, juste en dessous du pli de l'aine, est le canal par lequel passent les artères qui alimentent les jambes en sang. Les hernies qui se produisent ici sont nommées hernies fémorales (ou crurales). Ces hernies fémorales sont rares et se manifestent le plus souvent chez la femme, probablement pour des raisons anatomiques (forme du bassin).
La hernie inguinale "vraie" représente 96% des hernies de l'aine. La hernie fémorale ou crurale est beaucoup plus rare et touche surtout les femmes. Une hernie fémorale s'accompagne d'un risque d'étranglement élevé.
Certaines hernies restent asymptomatiques, ce qui veut dire qu'elles ne provoquent pas de plaintes particulières. Quand il y a des symptômes, il s'agit le plus souvent d'une sensation de lourdeur, d'inconfort ou de douleur légère, mais lancinante. Les symptômes sont surtout ressentis quand une pression s'exerce sur la région abdominale, par exemple quand on soulève un poids ou que l'on est constipé.
Dans de rares cas, la hernie s'accompagne d'une douleur intense. Cela peut indiquer un étranglement de l'intestin dans le passage à travers la paroi abdominale. Dans ce cas, il n'est pas possible de repousser la hernie vers l'intérieur. Une telle hernie étranglée se caractérise par une douleur croissante avec fréquemment des nausées et vomissements. A cause de l'interruption de la circulation sanguine, une partie de l'intestin peut se nécroser. Une hernie étranglée doit être opérée d'urgence.
Dans de rares cas, la hernie s'accompagne d'une douleur intense. Cela peut être le signe d'une hernie étranglée, nécessitant une opération urgente.
Ce n'est que dans des cas particuliers qu'un recours à l'imagerie médicale est indiqué. C'est notamment le cas lorsque les plaintes sont fortement suggestives d'une hernie, mais qu'aucune protubérance n'est visible. Ou, encore, quand il y a une protubérance, mais qu'il n'est pas tout à fait clair s'il s'agit bien d'une hernie. Les examens possibles sont alors essentiellement la radiographie, l'IRM et l'échographie.
L'échographie est disponible partout et n'entraîne pas de risques. Cependant, pour confirmer ou exclure une hernie inguinale, l'échographie est moins fiable que d'autres techniques d'imagerie médicale et son interprétation correcte nécessite beaucoup d'expertise.
De ce point de vue, l'IRM ("imagerie par résonance magnétique") est plus fiable et - si toutes les précautions sont respectées - également dénuée de risques. Mais on ne trouve pas un scanner IRM à chaque coin de rue...
La radiographie aussi peut parfois être utile en cas de doute. C'est un examen fiable. Son inconvénient est que, pour visualiser une hernie, on doit injecter un produit de contraste. Exceptionnellement, cela peut donner des complications (réaction allergique au produit, blessure de l'intestin, hématome, douleur...).
Dans des cas spécifiques, on peut aussi avoir recours à un CT scan.
Dans l'immense majorité des cas, un simple examen physique suffit pour poser le diagnostic. Ce n'est qu'en cas de doute qu'un examen par imagerie médicale peut être utile.
Pour traiter une hernie, il faut l'opérer. Mais toute intervention chirurgicale entraîne des risques. Il faut donc se demander s'il est nécessaire d'opérer toutes les hernies, même celles qui n'entraînent pas de symptômes gênants.
On a longtemps affirmé qu'il fallait toujours opérer. Un des arguments invoqués étant le risque d'étranglement du segment d'intestin dans le sac herniaire. Si cela se produit, l'intestin peut se nécroser. Pour prévenir cette éventuelle complication, il faut toujours opérer, disait-on, même si la hernie ne gêne pas le patient. D'autres arguments encore étaient avancés. Cependant, des études ayant évalué les conséquences d'une attitude expectative prudente ("watchful waiting") ont montré que, chez des hommes avec une hernie inguinale peu symptomatique, ne pas opérer tant que la situation ne s'aggrave pas est parfaitement défendable et n'entraîne pas de conséquences graves. Le risque d'étranglement de la hernie reste très limité. Il faut aussi tenir compte du fait que même une opération très sûre, comme celle de la hernie, comporte des risques. De surcroît, après l'opération, certaines personnes développent des douleurs chroniques à cause de l'intervention (par exemple suite à la lésion d'un nerf). Pour quelqu'un qui, avant l'opération, ne souffrait pas de sa hernie, cela peut être dramatique. Il faut donc bien peser le pour et le contre. Si la hernie n'entraîne pas de véritable gêne, on peut demander au médecin si une attitude expectative est envisageable. Attention : cela ne vaut pas pour les hernies fémorales, qui ont un risque d'étranglement particulièrement élevé et qu'il est donc prudent de toujours traiter, même en l'absence de plaintes.
Les documents d'information sur la hernie de l'aine de certains hôpitaux ne pipent mot de la possibilité d'une attitude expectative prudente et suggèrent qu'il faut toujours opérer toutes les hernies. Cela n'est pas correct et le patient ne doit pas s'en laisser conter.
Il existe un grand nombre de techniques opératoires différentes, mais l'on peut distinguer deux grands groupes : les opérations ouvertes et les opérations par laparoscopie. Pour une opération ouverte, on fait une incision assez longue, on opère et on referme. Pour une laparoscopie, on opère à travers trois minuscules incisions dans la paroi abdominale.
Les hernies inguinales sont aujourd'hui le plus souvent réparées en utilisant un filet de renfort ou "mesh". On évite ainsi de créer une forte tension sur les tissus.
Très souvent, le patient peut rentrer chez lui le jour même. Bien sûr, une hospitalisation plus longue peut parfois être indiquée, par exemple pour des seniors peu autonomes ou avec d'autres problèmes de santé.
Lors d'une opération laparoscopique, le chirurgien opère via de minuscules incisions. Un laparoscope, qui permet de visualiser la hernie sur un écran, et des instruments chirurgicaux sont introduits à travers les incisions. Un gaz est insufflé pour créer plus d'espace et faciliter l'opération. Sur l'écran, le chirurgien peut observer ce qu'il fait. La portion d'intestin qui fait protubérance est replacée dans la cavité abdominale et le sac herniaire est éliminé. L'ouverture par où passait la hernie est fermée par un filet en matière synthétique, placé à l'arrière de la zone faible, sous la couche musculaire.
Il existe plusieurs variantes de l'opération par laparoscopie. Les techniques avec lesquelles on a le plus d'expérience sont la méthode TEP et la méthode TAPP. Dans la méthode TAPP (voie trans-péritonéale) le chirurgien aborde la hernie par la cavité abdominale. Cela nécessite l'ouverture et la fermeture du péritoine. Dans la méthode TEP (voie extra-péritonéale) on ne passe pas dans la cavité abdominale, mais on reste dans l'espace entre les muscles et le péritoine. Chaque méthode a ses avantages et inconvénients propres.
Très souvent, le patient peut rentrer chez lui le jour même. Bien sûr, une hospitalisation plus longue peut parfois être indiquée, par exemple pour des seniors peu autonomes ou avec d'autres problèmes de santé.
Pour quel type d'opération opter : une chirurgie ouverte ou une chirurgie laparoscopique ? Nous examinons quelques-unes des différences entre les deux catégories, qui peuvent orienter la décision. Bien sûr, on n'a pas toujours le choix. Par exemple, si la hernie est très volumineuse ou ne peut être repoussée vers l'intérieur, une opération ouverte s'impose. Et nous ne pouvons ici présenter tous les facteurs susceptibles d'influencer le choix. Mais les informations suivantes peuvent vous être utiles pour en parler avec le médecin.
- Anesthésie. L'opération par laparoscopie nécessite normalement une anesthésie générale, ce qui veut dire que le patient est totalement endormi. Pour une opération ouverte, en revanche, on peut aussi opérer sous anesthésie locorégionale (seule la partie inférieure du corps est rendue insensible, par exemple par une péridurale) ou sous anesthésie locale (seule la zone d'opération est anesthésiée). Comparée à une anesthésie générale ou locorégionale, l'anesthésie locale a divers avantages et est considérée comme plus sûre. Pourtant, pour les opérations ouvertes de la hernie, l'anesthésie locale ne semble que rarement proposée en Belgique. Au patient alors de demander pourquoi.
- Complications graves. Les opérations par laparoscopie vont de pair avec un léger risque de certaines complications graves, comme une perforation de la vessie ou des lésions aux vaisseaux. Toutefois, les études indiquent qu'avec un chirurgien expérimenté, ce risque devient négligeable. Si vous envisagez une laparoscopie, essayez de vous informer sur l'expérience de l'hôpital avec ce type d'opération.
- Durée de l'intervention. On dit souvent qu'une opération laparoscopique prend plus de temps qu'une opération ouverte. Cela n'est pourtant pas confirmé par toutes les études. Et là où l'on a noté des différences, le gain de temps en faveur de la chirurgie ouverte ne dépassait pas 10 à 15 minutes. Pour le patient, une telle différence est sans conséquence. En règle générale, quelle que soit la technique opératoire, l'intervention ne dure pas plus d'une heure.
- Douleurs chroniques. Certaines personnes vont développer des douleurs chroniques après l'opération, le plus souvent à cause de l'atteinte d'un nerf. Les chiffres diffèrent selon les études, mais 10% semble une estimation réaliste. Ce risque de douleurs chroniques serait plus élevé avec les opérations ouvertes qu'avec les opérations laparoscopiques.
- Cicatrices. Les petites incisions pratiquées lors d'une laparoscopie seront ensuite quasi invisibles. La chirurgie ouverte laisse une cicatrice relativement grande. Certaines personnes peuvent trouver cela important.
- Reprise des activités. Après une laparoscopie, on peut normalement reprendre plus rapidement ses activités quotidiennes. Par exemple retourner au travail après une semaine plutôt que deux en cas de chirurgie ouverte. Intéressant pour certains, moins important pour d'autres.
- Les coûts. Pour certains, le prix peut-être un critère important. Actuellement, une opération laparoscopique coûte plus cher au patient qu'une opération ouverte. Ainsi, un assuré normal dans une chambre à deux personnes paie de sa poche pour une laparoscopie en moyenne 600 euro, contre 300 euro pour une opération ouverte. La durée de l'hospitalisation influence bien sûr aussi le prix total. Sachez aussi que, pour la même opération, il peut y avoir des différences de prix importantes entre les hôpitaux. Il est donc utile de bien s'informer au préalable sur les coûts, d'autant plus que l'opération de la hernie est rarement urgente.
L'opération par laparoscopie se déroule normalement sous anesthésié générale. En cas d'opération ouverte, on peut aussi opter pour une anesthésie locorégionale (seul le bas du corps est endormi) ou locale (seule la zone d'opération est insensibilisée).
La chirurgie de la hernie de l'aine connaît relativement peu de complications, mais des problèmes plus ou moins graves ne peuvent jamais totalement être exclus. Quelques exemples.
- Douleurs chroniques. On estime que jusqu'à 10% des patients développent des douleurs chroniques plus ou moins sévères, par exemple parce que le chirurgien a touché un nerf. Une perte de sensibilité dans la zone opérée est également une complication possible.
- Hématomes. Une certaine accumulation de sang (hématome) est normale et se caractérise par une décoloration bleue, qui peut descendre jusqu'à la base du pénis et au scrotum ou jusqu'aux grandes lèvres chez la femme. Les petits hématomes se résorbent normalement en quelques semaines. Si l'hématome est plus important et douloureux ou crée une tension importante sur la peau, on doit parfois l'évacuer (ce qui requiert une anesthésie).
- Infection de la plaie. Les infections superficielles sont rares après une laparoscopie (moins de 1%) et un peu plus fréquentes après une opération ouverte (1 à 3%). Les infections profondes sont exceptionnelles.
- Rétention urinaire. Le risque de rétention d'urine (impossibilité d'uriner) dépend, entre autres, du type d'anesthésie. Une analyse en 2002 donnait les résultats suivants : rétention dans 0,37% des cas après anesthésie locale ; dans 2,42% des cas après anesthésie locorégionale ; dans 3% des cas après anesthésie totale. Normalement, cela passe spontanément, mais parfois il faut vider la vessie au moyen d'une sonde.
- Organes sexuels. Dans des cas très rares, il peut se produire une inflammation du cordon spermatique ou une orchite (inflammation du testicule). Cela nécessite alors un traitement médicamenteux.
L'apparition de douleurs chroniques après opération est une complication qui n'est pas si rare et qui peut constituer une gêne pour les activités quotidiennes.
On ne peut jamais totalement exclure que la hernie récidive plus ou moins vite après l'opération.
Sauf exception, le port d'un bandage herniaire n'est pas recommandé.