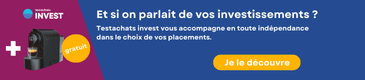Retard de paiement : quels sont vos droits et obligations ?

Sur cette page
- Nouvelles règles sur les retards de paiement et les recouvrements
- Dans quels cas s’appliquent les nouvelles règles sur les retards de paiement?
- A quelles entreprises les nouvelles règles s'appliquent-elles ?
- Retard de paiement : quels sont mes droits en vertu des nouvelles règles ?
- Que faire en cas de rappel de paiement ?
Nouvelles règles sur les retards de paiement et les recouvrements
En 2023, les règles relatives aux retards de paiement et au recouvrement amiable des créances ont été radicalement modifiées par l'ajout d'un nouveau livre XIX au Code de droit économique (CDE).
Les nouvelles règles sont applicables depuis un certain temps déjà, mais de nombreuses questions restent en suspens.
Les nouvelles règles s'appliquent-elles également aux anciens contrats ? Le rappel gratuit concerne-t-il également les factures d'hôpital ou d'énergie ? Et qu'en est-il des clauses pénales ?
Ce dossier passe en revue toutes les informations importantes et répond aux questions les plus fréquentes.
Situations dans lesquelles on peut avoir un retard de paiement
Dans quels cas s’appliquent les nouvelles règles sur les retards de paiement?
Les nouvelles règles s'appliquent à tout retard de paiement d'un consommateur à une entreprise. Attention : ces règles concernent le recouvrement amiable des dettes. Dès qu'un tribunal est impliqué, ces règles ne sont donc plus d’application.
Certains secteurs font l’objet d’une législation spécifique
S'il existe des règles spécifiques pour un certain secteur ou un certain type de contrat, celles-ci prévalent normalement sur les nouvelles règles. C'est le cas, par exemple, du secteur des télécommunications ou d'un crédit à la consommation. Les nouvelles règles ne sont dès lors d’application que pour les aspects qui restent en-dehors du champ de la législation plus spécifique.
La loi sur les télécoms, par exemple, contient des règles pour un rappel gratuit, qui prévalent sur les règles du livre XIX CDE. Mais la même loi sur les télécoms ne dit rien sur les clauses pénales, de sorte que les nouvelles règles sur les clauses pénales s'appliquent également aux contrats de télécoms. Voici une liste des secteurs et des contrats les plus courants couverts par une législation spécifique :
- Secteur des télécoms : la loi sur les télécoms prévoit des règles spéciales pour les retards de paiement. La gratuité du premier rappel y figurait déjà, et les frais des rappels suivants ne peuvent pas excéder 10 euros. La loi sur les télécoms offre également une protection supplémentaire aux consommateurs en retard de paiement. En effet, un opérateur de télécommunications ne peut pas décider d'interrompre purement et simplement ses services en cas de non-paiement. Toutefois, la loi sur les télécoms est muette sur les clauses pénales, de sorte que les plafonnements du livre XIX du CDE s'appliquent également aux contrats de ce secteur. De plus amples informations sur la protection des consommateurs dans le cadre des contrats de télécommunications sont disponibles ici.
- Secteur de l'énergie : Dans le secteur de l'énergie, des réglementations particulières à chacune des trois Régions protègent le consommateur qui ne parvient pas à payer une facture. Les nouvelles règles du livre XIX du CDE sur le plafonnement des clauses pénales s'appliquent en Flandre. En revanche, des plafonds différents s'appliquent à la Wallonie et à Bruxelles. Pour plus d'informations sur la protection des consommateurs dans les contrats d'énergie, cliquez ici.
- Crédit à la consommation : Le crédit à la consommation est régi par les dispositions spécifiques du livre VII du CDE. Celui-ci contient également des règles spécifiques en matière de rappel et de clauses d'indemnisation. Le livre XIX du CDE ne s'applique donc pas dans ce domaine.
- Crédit hypothécaire : le Livre VII du CDE prévoit également des règles particulières pour les prêts hypothécaires.
A quelles entreprises les nouvelles règles s'appliquent-elles ?
Qu'est-ce qu'une entreprise ?
Une entreprise est une personne physique ou morale qui poursuit un objectif économique de manière durable. Cette définition laisse place à un débat juridique. Une commune peut-elle être en même temps une entreprise si elle gère une piscine publique ? Et qu'en est-il des asbl ? Peuvent-elles être des entreprises même si, par définition, elles ne poursuivent pas de but lucratif ?
Cela dépend souvent de la situation. Une commune qui perçoit des droits pour la délivrance d'un passeport n'est pas une entreprise, mais cette même municipalité est quand même une entreprise si elle fait payer votre abonnement de natation. Et il n'est d’ailleurs pas nécessaire d'avoir un but lucratif pour être considéré comme une entreprise aux fins du livre XIX du CDE.
Vous trouverez ci-dessous une liste d'« entreprises » moins évidentes :
- Les hôpitaux et autres établissements de soins de santé sont généralement organisés en ASBL, mais relèvent néanmoins de la notion d'« entrepreneur » telle que décrite ci-dessus. Les règles du livre XIX du CDE s'appliquent.
- Les mutualités sont également couvertes par les nouvelles règles du livre XIX du CDE.
- Les associations de loisirs peuvent également être considérées comme des entreprises au sens du Livre XIX du CDE, dans la mesure où elles proposent également à des tiers des services ou des biens contre paiement. Si elles n'offrent que des services (par exemple, la location d'un court de tennis) à leurs membres, elles ne sont pas considérées comme des entreprises.
- Les établissements d'enseignement tombent parfois sous le coup des nouvelles règles s'ils offrent des services ou des biens en dehors de leur mission d'intérêt général. Ainsi, une école n'est pas soumise aux nouvelles règles pour sa mission éducative, mais bien pour les repas qu'elle propose aux étudiants moyennant paiement.
- Les institutions publiques tombent parfois sous le coup des nouvelles règles si elles offrent des services ou des biens en dehors de leur mission d'intérêt général. Par exemple, si la commune perçoit une redevance pour la délivrance d'un passeport, elle ne tombe pas sous le coup des nouvelles règles. C’est par contre le cas pour l'exploitation de la piscine municipale ou de la bibliothèque locale.
Les règles s'appliquent-elles également aux anciens contrats ?
Les nouvelles règles s'appliquent aux nouveaux contrats depuis le 1er septembre 2023. Toutefois, elles concernent aussi les contrats plus anciens conclus avant le 1er septembre 2023, mais uniquement pour les défauts de paiement intervenus après le 1er décembre 2023.
Cela signifie que les nouvelles règles s'appliquent en fait aujourd’hui à presque tous les retards de paiement, à moins bien sûr qu'il ne s'agisse d'une dette non couverte par les règles du Livre XIX CDE.
Qu'en est-il si vous avez acheté quelque chose dans une boutique en ligne étrangère ?
Ces règles s'appliquent-elles également à un contrat avec une entreprise étrangère ? Parfois oui, mais cela dépend de nombreux facteurs. Si vous achetez sur une boutique en ligne étrangère ciblant le marché belge, les dispositions du livre XIX du CDE s'appliquent normalement.
Le fait qu'une boutique en ligne cible notre marché dépend de nombreux facteurs. Si la boutique en ligne est disponible dans notre langue nationale et qu'elle possède une adresse URL finissant par .be, c'est une bonne indication que c'est bien le cas. Toutefois, si vous achetez sur une boutique en ligne qui ne cible pas spécifiquement le marché belge, la situation est moins claire.
Retard de paiement : quels sont mes droits en vertu des nouvelles règles ?
Le premier rappel gratuit
En cas de retard de paiement, vous avez désormais droit à la gratuité du premier rappel. Il existe toutefois une exception pour les contrats portant sur la fourniture régulière de biens ou de services. Pensez par exemple à un abonnement. Si vous avez déjà reçu un premier rappel gratuit trois fois au cours d'une année civile, le créancier peut vous facturer 7,50 euros plus les frais d’envoi à partir du quatrième rappel.
Le premier rappel doit contenir suffisamment d'informations pour que vous sachiez exactement à quoi correspond la dette et qui la réclame. En particulier, les éléments suivants doivent être mentionnés :
- Le solde dû ainsi que le montant de la clause pénale qui sera réclamée si vous ne payez pas dans un délai de 14 jours ;
- Le nom et le numéro d'entreprise du créancier ;
- La description du produit ou du service sur lequel porte la dette et la date à laquelle vous deviez normalement payer ;
- Le délai qui vous est encore laissé pour payer.
Après ce rappel, vous disposez d'un nouveau délai de 14 jours pour payer la dette. Ce délai commence à courir le lendemain de l'envoi (pour un rappel par e-mail) ou trois jours ouvrables après l'envoi (pour un rappel par courrier).
Si vous n'avez toujours pas payé après ce dernier délai de paiement, le créancier peut donc réclamer des dommages et intérêts si une telle clause pénale figure dans votre contrat. Les PME bénéficient également d'une autre exception : si vous n'avez toujours pas payé après ces 14 jours, elles peuvent commencer à facturer des intérêts à partir du jour de l'envoi du rappel gratuit.
Plafonnement des clauses pénales
L'avancée de loin la plus importante du nouveau Livre XIX du RME est qu'il existe désormais des limites claires aux clauses pénales. Une telle clause permet à un créancier de réclamer un dédommagement au débiteur qui ne paie pas à temps.
Auparavant, ces clauses pénales étaient souvent disproportionnées, de sorte qu'une petite dette pouvait soudainement atteindre un montant exorbitant. Le nouvel article XIX.4 du CDE met un terme à ces pratiques abusives.
Désormais, une clause pénale peut exiger au maximum les éléments suivants :
- Des intérêts de retard sur le principal qui ne peuvent excéder un taux fixé par la loi. Ce taux légal est régulièrement adapté.
- Une indemnité forfaitaire qui ne peut excéder :
o 20 € si le solde dû est inférieur ou égal à 150 € ;
o 30 € plus 10 % du montant dû sur la tranche comprise entre 150,01 € et 500 € si le solde dû est compris entre 150,01 € et 500 € ;
o 65 € plus 5 % du montant dû sur la tranche supérieure à 500 € avec un maximum de 2 000 € si le solde dû est supérieur à 500 €.
Supposons que vous ayez une dette impayée de 300 €. Dans ce cas, la clause pénale peut être de maximum 30 € + 10 % sur la tranche comprise entre 150,01 € et 500 €, soit ici 10 % sur 150 €, donc 15 €, pour un total de 45 €.
Avec le nouveau plafond, une entreprise ne peut donc plus exiger que vous remboursiez tous les frais de l'huissier ou de l'agence de recouvrement. De plus, le nouveau Livre XIX du CDE stipule explicitement que ces derniers ne peuvent exiger aucune indemnité du débiteur dans le cadre du recouvrement amiable de la créance.
Par ailleurs, les anciennes exigences en matière de clause pénale sont toujours d'application. La clause pénale doit être suffisamment claire et vous devez pouvoir en prendre connaissance avant de signer le contrat, par exemple quand vous recevez un exemplaire des conditions générales et que vous les acceptez. En outre, le tribunal conserve la possibilité de contrôler la légalité de la clause et éventuellement de la déclarer nulle.
Enfin, il est également important de rappeler qu'une telle clause pénale ne peut entrer en vigueur qu'après le premier rappel gratuit et le délai de 14 jours dont vous disposez ensuite pour payer. Par conséquent, si vous respectez les délais à ce moment-là, vous ne devrez pas payer d'intérêts ou de dommages-intérêts forfaitaires.
Les nouvelles règles pour les agents de recouvrement amiable
Le nouveau Livre XIX du CDE contient également des règles concernant les agents de recouvrement amiable. Il s'agit notamment des sociétés de recouvrement, mais les huissiers de justice peuvent également intervenir à ce stade. Sachez cependant qu’un huissier de justice agissant en tant qu'agent de recouvrement amiable ne peut pas saisir vos biens - cela ne peut se faire que dans le cadre d’un recouvrement judiciaire qui nécessite qu’on soit d’abord passé par un tribunal.
Voici les principales règles applicables aux agents de recouvrement amiable dans le livre XIX du CDE :
- Un agent de recouvrement amiable doit être enregistré auprès du SPF Economie avant de pouvoir exercer ses activités en Belgique. Ceci vaut également pour les sociétés de recouvrement étrangères qui souhaitent recouvrer des créances en Belgique.
- L'agent de recouvrement amiable doit vérifier la créance avant de la recouvrer. Il doit également vérifier si les montants maximum des dommages et intérêts sont respectés.
- L'agent de recouvrement amiable doit toujours envoyer une mise en demeure avant toute autre mesure. Vous disposez d'un délai supplémentaire de 14 jours pour payer.
- Si le consommateur demande un plan de remboursement, introduit une demande de médiation de dettes ou conteste la dette de manière motivée, aucune autre mesure de recouvrement amiable ne peut être prise.
- L'agent de recouvrement amiable ne peut facturer aucun frais au consommateur.
Une mesure de recouvrement amiable est, par exemple, une visite à domicile, un appel téléphonique ou l'envoi d'une lettre de mise en demeure. Ces mesures sont toutefois soumises à des règles supplémentaires : par exemple, une visite à domicile ou un appel téléphonique ne peut jamais avoir lieu entre 22 heures et 8 heures du matin. Menacer, fournir des informations erronées, harceler des proches sont autant d'exemples de pratiques inacceptables.
Que faire en cas de rappel de paiement ?
Quand vous recevez un rappel de paiement, vous avez 14 jours pour payer la dette. Ce n'est qu'alors que la dette peut donner lieu à des intérêts et à un dédommagement forfaitaire, si cette possibilité était prévue dans votre contrat.
Si vous recevez un rappel de paiement, procédez comme suit :
1. Vérifiez la dette. Êtes-vous réellement redevable de la dette et le montant est-il correct ? Tenez également compte de l'éventualité d'une fraude à la facture ou d'un hameçonnage. Vérifiez que l'expéditeur du SMS, de la lettre ou de l'e-mail est bien le créancier. Ne cliquez pas sur un lien de paiement si vous n'êtes pas sûr à 100 % qu'il est fiable. Il est souvent préférable de se rendre soi-même sur le site web du créancier, par exemple, pour y effectuer le paiement. Vous éviterez ainsi les faux sites web. Et si vous n'êtes pas sûr de devoir quelque chose, recherchez vous-même le numéro de téléphone ou l'adresse électronique du créancier et contactez-le. Vous éviterez ainsi de rappeler la fausse adresse d'un escroc. Vous trouverez plus d'informations su la fraude sur internet dans notre dossier.
2. S'il s'agit d'une dette ancienne, vérifiez si le délai de prescription n'est pas expiré. Si c'est le cas, vous avez légalement le droit de refuser de payer la dette. En effet, les dettes ne peuvent pas être réclamées indéfiniment. Quelques exemples : pour une facture d'hôpital, le délai de prescription est de 2 ans, et il est de 5 ans pour une facture de votre fournisseur d'énergie. Notez toutefois que certains actes du créancier peuvent interrompre ou suspendre le délai de prescription, par exemple s'il vous assigne en justice. Le délai de prescription est également interrompu si vous reconnaissez vous-même la dette. Pour en savoir plus, consultez notre dossier sur la prescription des dettes.
3. Payez la dette. Si la dette est correcte et que vous devez effectivement l'argent réclamé, il est préférable de payer le plus rapidement possible. Vous éviterez ainsi des frais supplémentaires.
4. Contestez la dette. Vous n'êtes pas d'accord avec la créance ? Dans ce cas, il est préférable de la contester dès que possible, par écrit et de manière motivée, en respectant la procédure appropriée. Si vous avez reçu une mise en demeure d'un agent de recouvrement amiable, cette procédure doit également être décrite dans la mise en demeure. En contestant, vous évitez des situations désagréables, comme l'appel téléphonique d'une agence de recouvrement ou la visite à domicile d'un huissier. Le créancier (et l'agent de recouvrement amiable) ne peut alors plus vous importuner jusqu'à ce qu'une décision soit prise sur votre contestation. Veillez également à conserver les preuves de votre contestation fondée.
5. Demandez un plan de remboursement. Vous devez effectivement de l'argent, mais vous n'avez pas assez d'argent pour payer la dette ? Demandez alors un plan de remboursement. Vous éviterez ainsi une escalade avec des agences de recouvrement ou des poursuites judiciaires. Ensuite, suivez scrupuleusement le plan de remboursement.
6. Vous avez des doutes sur la réalité de votre dette ? Dans ce cas, vous pouvez contacter notre service de conseil.
APPELEZ NOS EXPERTS JURIDIQUES AU 02 542 32 00
Vers le haut de la page