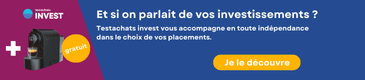Myome


Des tumeurs peuvent apparaître dans l’utérus de certaines femmes : les myomes. Elles créent rarement des problèmes et ne sont même souvent pas détectées. Mais elles sont tout de même source d’inquiétude. Que faut-il savoir ?
La taille des tumeurs et la vitesse à laquelle elles se développent diffèrent d’une femme à l’autre et sont donc imprévisibles. Parfois, les tumeurs ne sont pas plus grandes qu’un petit pois, mais parfois aussi, elles peuvent atteindre la taille d’un ballon de football. Elles se développent à l’extérieur ou à l’intérieur de la paroi de l’utérus.
Les myomes font partie des tumeurs les plus fréquentes chez les femmes, mais elles sont presque toujours bénignes. Elles apparaissent aux environs de 30-40 ans. Après la ménopause, elles diminuent la plupart du temps en nombre et en taille.
Le risque de développer un myome malin est très faible : il apparaît que seul 0,1 %des femmes qui développent un myome ont une tumeur maligne. La tumeur la plus fréquente est le léiomyosarcome, pour lequel il n’existe pas encore de traitement. Le gros problème, c’est qu’on ne peut pas distinguer les cellules malignes des cellules bénignes à l’échographie ou lors d’un IRM.
Quand on opère, on ne sait donc pas avec certitude si la tumeur retirée est cancéreuse ou non. S’il s’agit de cellules malignes, elles peuvent se disséminer et la patiente peut se retrouver subitement au stade du cancer terminal. Il est donc très important que l’endoscopie soit effectuée correctement et avec circonspection. La patiente peut aussi subir une opération durant laquelle l’utérus est opéré hors du ventre pour limiter le risque de dispersion des cellules.
La taille des tumeurs et la vitesse à laquelle elles se développent diffèrent d’une femme à l’autre et sont donc imprévisibles. Parfois, les tumeurs ne sont pas plus grandes qu’un petit pois, mais parfois aussi, elles peuvent atteindre la taille d’un ballon de football. Elles se développent à l’extérieur ou à l’intérieur de la paroi de l’utérus.
Les myomes font partie des tumeurs les plus fréquentes chez les femmes, mais elles sont presque toujours bénignes. Elles apparaissent aux environs de 30-40 ans. Après la ménopause, elles diminuent la plupart du temps en nombre et en taille.
Le risque de développer un myome malin est très faible : il apparaît que seul 0,1 %des femmes qui développent un myome ont une tumeur maligne. La tumeur la plus fréquente est le léiomyosarcome, pour lequel il n’existe pas encore de traitement. Le gros problème, c’est qu’on ne peut pas distinguer les cellules malignes des cellules bénignes à l’échographie ou lors d’un IRM.
Quand on opère, on ne sait donc pas avec certitude si la tumeur retirée est cancéreuse ou non. S’il s’agit de cellules malignes, elles peuvent se disséminer et la patiente peut se retrouver subitement au stade du cancer terminal. Il est donc très important que l’endoscopie soit effectuée correctement et avec circonspection. La patiente peut aussi subir une opération durant laquelle l’utérus est opéré hors du ventre pour limiter le risque de dispersion des cellules.
Plus graves sont les myomes qui menacent la fertilité. Si un myome croît juste à la jonction entre l’utérus et l’ovaire, il peut empêcher la nidification de l’ovule dans l’utérus, ce qui explique que la plupart des myomes sont découverts à l’occasion de problèmes d’infertilité.
Pour le dépistage des myomes plus petits ou pour avoir la confirmation du diagnostic, on réalise le plus souvent une échographie.
Dans certains cas, il est plus prudent de réaliser une radiographie, une IRM ou un scanner.
La majorité des femmes ayant un myome ne se plaignent pas. C’est ainsi que souvent on ne démarre aucun traitement.
Les femmes dont les symptômes sont sérieux peuvent être soulagées temporairement par des médicaments. Elles peuvent prendre des analgésiques pour adoucir la douleur et les crampes et se soigner temporairement. On peut traiter des pertes de sang excessives à l’aide d’une thérapie hormonale orale ou locale (stérilet). Ces médications peuvent calmer les gênes durant la période précédant une opération chirurgicale ou la ménopause.Les autres médicaments utilisés durant la période précédant une opération peuvent aussi être la triptoreline, qui engendre une ménopause artificielle, et l’ulipristal. Ces deux traitements maîtrisent les saignements excessifs et réduisent le volume des myomes. Ce ne sont toutefois pas des solutions permanentes, en particulier pour les femmes qui désirent procréer. Il n’y a pas de preuves scientifiques suffisantes prouvant que ces médications donnent un meilleur pronostic pour l’intervention chirurgicale qui s’ensuit. De plus, ces médicaments ont souvent des effets secondaires lourds et ennuyeux.
Les myomes à l’origine de troubles gênants ou qui empêchent une grossesse sont enlevés chirurgicalement. S’il se trouve à l’extérieur de l’utérus, on opère en incisant la paroi abdominale (laparoscopie), sur 5 à 10 mm. Après avoir détaché le myome de la paroi de l’utérus, on le déchiquète en particules minuscules et on l’aspire. Cette intervention dure en moyenne trois heures, sous anesthésie générale. Si le myome se trouve à l’intérieur, c’est-à-dire dans la cavité utérine, on introduit un instrument par le vagin et le col de l’utérus (hystéroscopie). Si les femmes veulent épargner leur utérus, il existe une alternative qui consiste à bloquer les vaisseaux sanguins (embolie) qui approvisionnent le myome, ce qui peut faire rétrécir la tumeur de 30 à 45 %.
Le traitement le plus radical contre les symptômes sérieux est l’ablation de l’utérus (hystérectomie). C’est une option pour les femmes à l’âge de la préménopause ou pour celles qui ne veulent pas d’enfants.
Selon la première, les myomes se développeraient sous l’influence de l’œstrogène et de la progestérone, deux hormones féminines. Dès qu’une femme est ménopausée, la production d’hormones diminue et, avec elle, la croissance de myomes. Parfois, les tumeurs commencent à se contracter ou disparaissent même complètement.
Selon une deuxième hypothèse, le développement des myomes serait génétiquement déterminé. Cette théorie est confortée par le fait que certaines femmes y sont plus sensibles que d’autres et par les fortes différences entre les races. Les femmes africaines, afro-américaines et afro-caribéennes sont plus souvent affligée de fibromes, et à un plus jeune âge. Les femmes asiatiques sont les moins concernées, tandis que les femmes blanches se situent entre ces groupes.