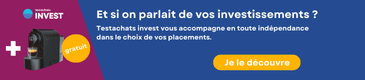Trouble panique


Au cours de son existence, une personne sur trois connaît une crise de panique, une vague soudaine d’anxiété intense ou de malaise sans raison apparente. Lorsqu’une telle crise se manifeste à plusieurs reprises en peu de temps, nous parlons de trouble panique.
La panique est une peur ou une angoisse soudaine et intense qui nous submerge suite à une menace. Elle peut être physique (lorsqu’on vous attaque en rue), ou psychologique (ex. un échec à l’école ou au travail). L’angoisse remplit une fonction importante, parce qu’elle entraîne la lutte contre le danger ou la fuite.
Toutefois, il est possible qu’une angoisse importante vous assaille sans qu’il soit question d’un réel danger. Une fausse alerte en somme. Notre organisme réagit avec des symptômes sévères, comme de la tachycardie ou de l’hyperventilation (accélération de la respiration). Il ne s’agit plus d’une réaction adaptative, mais d’une pathologie: une crise de panique.
En cas de manifestation régulière de ce genre de crises imprévisibles et lorsque celles-ci occasionnent de l’angoisse supplémentaire pendant plus d’un mois à l’idée d’une nouvelle attaque ou entraînent un comportement déviant (comme l’évitement de situations anxiogènes), nous parlons de trouble panique.
Facteurs de risque
Il est probable que les crises soient déclenchées par une combinaison d’hérédité, de facteurs circonstanciels comme une jeunesse difficile et des déclencheurs spécifiques comme un stress aigu ou chronique. Certains traits de personnalité, comme une sensibilité à la culpabilité, la colère ou le chagrin sont des facteurs de risque.
Les femmes ont deux fois plus de risque de développer un trouble panique que les hommes. Des affections comme une glande thyroïde hyperactive, des problèmes pulmonaires comme de l’asthme ou un trouble de stress post-traumatique peuvent par exemple déclencher des crises de panique.
Si les crises sont déclenchées par un médicament, de la drogue, une affection médicale ou un autre trouble psychiatrique, il ne s’agit pas d’un trouble panique.
La panique est une peur ou une angoisse soudaine et intense qui nous submerge suite à une menace. Elle peut être physique (lorsqu’on vous attaque en rue), ou psychologique (ex. un échec à l’école ou au travail). L’angoisse remplit une fonction importante, parce qu’elle entraîne la lutte contre le danger ou la fuite.
Toutefois, il est possible qu’une angoisse importante vous assaille sans qu’il soit question d’un réel danger. Une fausse alerte en somme. Notre organisme réagit avec des symptômes sévères, comme de la tachycardie ou de l’hyperventilation (accélération de la respiration). Il ne s’agit plus d’une réaction adaptative, mais d’une pathologie: une crise de panique.
En cas de manifestation régulière de ce genre de crises imprévisibles et lorsque celles-ci occasionnent de l’angoisse supplémentaire pendant plus d’un mois à l’idée d’une nouvelle attaque ou entraînent un comportement déviant (comme l’évitement de situations anxiogènes), nous parlons de trouble panique.
Facteurs de risque
Il est probable que les crises soient déclenchées par une combinaison d’hérédité, de facteurs circonstanciels comme une jeunesse difficile et des déclencheurs spécifiques comme un stress aigu ou chronique. Certains traits de personnalité, comme une sensibilité à la culpabilité, la colère ou le chagrin sont des facteurs de risque.
Les femmes ont deux fois plus de risque de développer un trouble panique que les hommes. Des affections comme une glande thyroïde hyperactive, des problèmes pulmonaires comme de l’asthme ou un trouble de stress post-traumatique peuvent par exemple déclencher des crises de panique.
Si les crises sont déclenchées par un médicament, de la drogue, une affection médicale ou un autre trouble psychiatrique, il ne s’agit pas d’un trouble panique.
Un trouble panique est caractérisé par des crises de panique qui se manifestent soudainement et s’aggravent en peu de temps. Elles peuvent durer de quelques minutes à une heure et surviennent de manière imprévisible et incontrôlable, même chez un sujet parfaitement calme quelques minutes auparavant. Une crise se ressent comme une angoisse ou une sensation d’inconfort qui s’intensifie et entraîne au moins quatre des symptômes suivants:
- De la tachycardie ou un pouls accéléré.
- Transpiration.
- Agitation ou tremblements.
- Essoufflement.
- Sensation d’asphyxie.
- Douleur ou gêne dans la poitrine.
- Nausées ou maux de ventre.
- Vertiges, étourdissements ou évanouissements.
- La sensation de ne pas être ancré dans la réalité (déréalisation) ou d’être détaché de soi (dépersonnalisation).
- Crainte de perdre le contrôle ou de devenir fou.
- Peur de mourir.
- Insensibilité, fourmillements ou démangeaisons.
- Frissons ou bouffées de chaleur.
Entre les crises, la crainte d’une nouvelle attaque persiste; celle-ci est appelée anxiété anticipatoire. La crainte d’une crise future et son imprévisibilité peuvent être véritablement épuisantes. Les sujets vont alors éviter les situations desquelles ils ont l’impression de ne pas pouvoir s’échapper ou de ne pas pouvoir obtenir de l’aide. Dans les cas extrêmes, cela entraîne un isolement complet.
Pour les sujets en proie à ce genre de crise de panique, cela peut ressembler à une crise cardiaque. Alors que certaines personnes contactent en premier lieu leur médecin traitant, d’autres se rendent aux urgences. Mais si la personne peut avoir l’impression que sa vie est en danger, ce n’est pas le cas. Les symptômes disparaissent généralement en quelques minutes.
Sur la base des symptômes, du contexte et du déroulement de la crise, le médecin sera en mesure de poser assez facilement le diagnostic. En cas de doute, certaines analyses permettent d’exclure d’autres causes possibles comme l’épilepsie ou les problèmes pulmonaires.
Il importe de rechercher rapidement un traitement pour un trouble panique, car chaque attaque confirme la cognition problématique qu’elle déclenche de nouvelles attaques.
L’angoisse constante peut en outre déboucher sur d’autres complications, comme de la dépression ou une assuétude (alcool, drogues etc.).
Les plus efficaces sont les traitements psychologiques et pharmacologiques, combinés entre eux ou non. Une approche non-médicamenteuse est meilleure en raison de ses effets à long terme et l’absence d’effets secondaires. Un psychologue ou un psychiatre établit un programme d’exercices pour apprendre à maîtriser les angoisses ou la panique.
Généralement, des thérapies cognitives et comportementales (TCC) sont recommandées. L’une des techniques utilisées dans la TCC est la restructuration cognitive, dans laquelle les cognitions irrationnelles derrière l’anxiété sont identifiées et modifiées. Bref: le sujet apprend à penser différemment. Les scénarios catastrophe durant une crise de panique, les pensées telles que "je meurs", "cela ne s’arrêtera jamais" ou "je vais me rendre ridicule" ne font qu’alimenter votre anxiété. Avec votre thérapeute, vous apprenez à les remettre en question.
Dans le cas de la thérapie d’exposition, vous vous exposez progressivement aux sensations corporelles liées à la panique, pour apprendre progressivement à les supporter.
L’auto-assistance à base de techniques TCC peut s’avérer également utile si vous ne parvenez pas à obtenir rapidement un rendez-vous avec votre thérapeute. Vous effectuez dans ce cas vous-même des exercices, comme de la décontraction musculaire ou des techniques respiratoires.
Il a également été prouvé qu’une thérapie psychodynamique de courte durée peut fonctionner. Là, on part du principe que bon nombre de nos problèmes psychiques et bien souvent physiques remontent à des expériences de notre prime jeunesse comme un attachement perturbé entre le parent et l’enfant. La thérapie aide à prendre conscience de ces processus inconscients (sentiments, pensées et motifs enfouis) pour commencer à travailler sur ceux-ci.
Pour certains, il peut être utile d’éviter la caféine et l’alcool, étant donné qu’ils peuvent générer voire aggraver ces sentiments d’anxiété.
Lorsque la souffrance est très grave ou en cas d’échec de l’approche non-médicamenteuse, il est possible de recourir aux médicaments. À court terme, les benzodiazépines (calmants) peuvent chasser l’anxiété, mais ils entrainent un risque de dépendance ou de tolérance. À long terme, mieux vaut donc leur préférer certains antidépresseurs.
Une rechute est toujours possible. La thérapie vous apprend à gérer cette possibilité, de façon à pouvoir intervenir directement en cas de nouveaux symptômes, pour ainsi contrôler le plus rapidement possible les crises de panique. Avez-vous vous aussi droit au remboursement de l’aide psychologique? Vous le découvrirez à la lecture de notre dossier.
VERS LE DOSSIER REMBOURSEMENT DE L’AIDE PSYCHOLOGIQUE