Flore (ou microbiote) intestinale : des bactéries très utiles

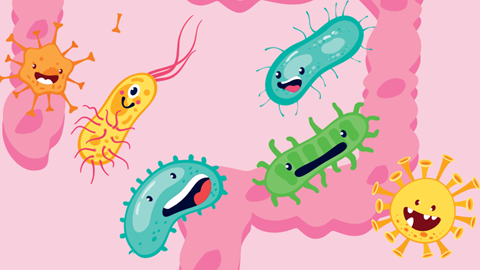
Autrefois appelé flore bactérienne, le microbiote intestinal se compose de micro-organismes qui interagissent les uns avec les autres, mais également avec le corps. Plus un jour ne passe sans qu’il n’y ait de nouvelles études sur le microbiote. Nos bactéries intestinales font depuis quelques années maintenant l’objet d’une attention particulière. Et pour cause, elles remplissent des fonctions aussi nombreuses qu’indispensables.
Elles sont entre autres impliquées dans l’immunité, la digestion et la production de vitamines. Mais aussi dans de nombreuses pathologies, aussi diverses que variées: maladies inflammatoires de l’intestin, cancer du côlon, mais aussi obésité, diabète, allergies et même dépression et anxiété.
Il est donc nécessaire d’en prendre bien soin.
Comment prendre soin de son microbiote intestinal?
Les études de population ont montré l’influence certaine de l’alimentation sur la composition et la diversité du microbiote intestinal.
S’il n’est pas facile de montrer les effets de nutriments en particulier, l’alimentation de type occidental "trop gras, trop sucré, trop salé" a clairement montré un impact délétère. La consommation d’additifs (édulcorants intenses et émulsifiants) a par ailleurs été épinglée, mais davantage d’études sont nécessaires avant de conclure.
A l’inverse, le régime méditerranéen remporte encore une fois la palme pour la diversité microbienne qu’il génère. Dans le même ordre d’idées, on peut s’interroger sur les effets à long terme sur le microbiote des régimes sans gluten suivis par des personnes ne souffrant pas de maladie coeliaque (intolérance au gluten). Quelques études ont en effet démontré l’augmentation de certaines bactéries nuisibles dans la muqueuse intestinale des personnes en bonne santé qui suivent ce régime.

Une science en plein essor
Lorsque la pathologie est lourde, d’autres solutions doivent parfois être mises en place. L’antibiothérapie a, par exemple, fait ses preuves dans la lutte contre les Clostridium qui peuvent engendrer des maladies comme le botulisme. Mais, bien que nécessaire, elle a aussi tendance à nettoyer le microbiote intestinal de ses bonnes bactéries.
Depuis une dizaine d’années, la transplantation fécale ouvre, elle aussi, de nouvelles voies. Elle a ainsi montré d’excellents résultats dans les infections chroniques à Clostridium difficile, seule indication dans laquelle elle a fait ses preuves pour l’instant.
Mais la science du microbiote n’en est qu’à son adolescence et elle n’a pas fini de nous livrer tous ses secrets.
Tout commence à la naissance. Le nouveau-né est d’abord exposé aux micro-organismes de la flore vaginale et fécale de sa mère lors de l’accouchement. Il y est ensuite exposé grâce à l’allaitement, mais aussi au contact de son environnement et de son entourage. L’accouchement par voie basse favorise les entérobactéries et lactobacilles, contrairement à la césarienne. On constate que l’augmentation du nombre de césariennes et l’excès d’hygiène lors de l’accouchement favorisent une colonisation environnementale plutôt que maternelle.
Si après quelques années, la flore des tout-petits s’approche de celle des adultes, on a aussi montré que le tout début de vie est capital pour l’acquisition de l’immunité. L’influence de cette colonisation (voie basse ou césarienne) a donc forcément des implications, mais on ne sait pas exactement lesquelles et ce n’est pas forcément le cas pour tous les enfants (allergies...).
Tous ces facteurs, auxquels s’ajoutent l’alimentation du bébé et la médication éventuelle, forgent le microbiote intestinal qui se complexifie et arrive à maturité vers l’âge de 2-3 ans. Il restera alors constant tout au long de la vie adulte et évoluera avec l’âge, perdant en diversité au gré des traitements médicaux, de la diminution de l’immunité ou encore d’une alimentation moins variée.
Si chaque individu possède une flore qui lui est propre, un tiers des espèces présentes se retrouve chez tout le monde, et certaines de ces espèces se retrouvent chez 90% de l’Humanité. S’il existe donc bien des différences individuelles, on ne retrouve que trois entérotypes (groupes de composition bactérienne intestinale spécifique chez l’humain) selon les espèces dominantes au sein du microbiote intestinal: Bacteroides, Prevotella et Ruminococcus.
Ces entérotypes sont principalement façonnés par l’alimentation, les habitudes culturelles, l’ethnie et même l’exercice physique. Cette "composition microbienne" propre à chacun peut transitoirement être altérée par un traitement aux antibiotiques par exemple ou un changement de régime alimentaire lors de vacances à l’étranger, mais globalement, le microbiote intestinal est stable et revient de lui-même, à la normale.
Dans le meilleur des mondes, nous vivons en bonne santé et en parfaite harmonie avec notre microbiote intestinal, que l’on considère généralement comme un organe à part entière. Grâce à l'alimentation, nous nourrissons correctement nos bactéries intestinales qui en échange nous fournissent des métabolites indispensables à notre équilibre (càd des molécules issues de la transformation d’une substances par le métabolisme comme des acides aminés, des antioxydants, des vitamines...).
Digestion, immunité et vitamines
Sa mission la plus connue est sans doute sa fonction digestive. Les résidus alimentaires non digestibles au niveau de l’intestin (principalement les fibres que l’on retrouve dans tous les fruits et légumes et l’amidon résistant qui s’obtient en refroidissant les aliments riches en amidon comme les pâtes, le riz, les pommes de terre) sont fermentés par les bactéries coliques, produisant en retour des acides gras à chaînes courtes. Ces petites molécules (butyrate, acétate, propionate) servent, entre autres, à nourrir les cellules du côlon en garantissant par la même occasion son imperméabilité et son rôle de barrière. Le butyrate par exemple, pourrait prévenir le cancer colorectal. Les acides gras à chaînes courtes stimulent aussi le transit et activent la production des hormones de satiété. Il n’est donc pas étonnant que ces molécules soient reprises comme marqueurs de bonne santé intestinale dans l’étude de plusieurs pathologies
La fonction immunitaire est plus surprenante, pour qui ne s’y connaît pas. Le rôle de barrière face aux bactéries pathogènes est assez évident, mais cela va plus loin puisque les bactéries intestinales interviennent dans la maturité de notre système immunitaire, inné et acquis. Pas moins de 60% de nos cellules immunitaires se trouvent dans nos intestins.
On ajoutera également comme rôle essentiel, la production de vitamines (groupe B et K) et le métabolisme de certains xénobiotiques (substances indésirables).
Malheureusement, il se peut que l’équilibre du microbiote intestinal soit rompu. La flore bactérienne ne peut alors plus assumer ces diverses missions.
Déséquilibre de la flore : cause ou conséquence ?
La diversité et la richesse du microbiote intestinal sont synonymes de bonne santé. A l’inverse, une rupture de cet équilibre, aussi appelée dysbiose, est constatée dans de nombreuses pathologies, qu’il s’agisse de maladies intestinales (intestin irritable ou maladie de Crohn par exemple), métaboliques (obésité et diabète), allergies ou même la dépression.
Les études sur les souris stériles (sans microbiote) nous ont beaucoup appris. Des pathologies et même des comportements ont pu être "transmis" en transplantant simplement le microbiote de souris "malade" dans l’intestin des souris stériles. Et chez l’homme, ces faisceaux de présomptions ont clairement été confirmés. Les dysbioses peuvent être multiples, mais ont le point commun de voir une diminution de bactéries productrices d’acides gras à chaînes courtes. Aussi, la proportion de bactéries délétères tend à augmenter et à induire une situation pro-inflammatoire, appelée endotoxémie, augmentant la perméabilité de la paroi intestinale et provocant une réponse immunitaire.
Bon nombre d’affections sont associées à une dysbiose. Dans les maladies inflammatoires chroniques de l’intestin comme la maladie de Crohn ou la rectocolite hémorragique, le microbiote est une cible de choix pour le traitement. Les maladies métaboliques tels l’obésité et le diabète, sont toutes deux associées à une inflammation impliquant le microbiote intestinal et générant une insulinorésistance (associées à d’autres facteurs). Certaines bactéries comme Akkermansia municiphila font entrevoir une lueur d’espoir dans leur prise en charge. La flore intestinale semble également jouer un rôle dans le cadre du cancer colorectal et même au niveau de la réponse aux traitements anti-cancer.
La question cruciale à laquelle nous n’avons pourtant pas de réponse à ce jour est de savoir si ce déséquilibre de la flore est la cause ou conséquence de ces maladies. Les origines de ces affections sont multifactorielles comme la génétique, le stress et très indéniablement l’hygiène de vie. On peut donc raisonnablement supposer qu’il s’agit d’un cercle vicieux à considérer comme un tout et pouvant générer une affection. Mais le tableau n’est pas si sombre et en attendant que la science tranche sur la question, nous pouvons très certainement agir sur certains facteurs et prendre soin de notre microbiote intestinal.


