Accident vasculaire cérébral : symptômes, diagnostic et traitement

Les accidents vasculaires cérébraux sont plus fréquents que vous ne le pensez et peuvent changer des vies en quelques minutes. Plus vous reconnaissez rapidement les signes, plus les chances de guérison sont grandes. Dans ce dossier, vous apprendrez à reconnaître un AVC, ce qu'il faut faire immédiatement et quels sont les traitements et les possibilités de rééducation disponibles.

C’est quoi un AVC?
Un AVC (accident vasculaire cérébral) survient lorsqu’un problème se produit dans un vaisseau sanguin du cerveau. Un vaisseau sanguin peut se boucher ou se rompre. Des cellules cérébrales cessent alors subitement de fonctionner. Souvent, des symptômes clairs apparaissent immédiatement : bras ou jambe paralysé, bouche de travers, difficulté à voir, parler ou avaler. Les médecins parlent de déficience neurologique ou de perte de fonction.
Dans la plupart des cas, un AVC survient de manière inattendue. Mais souvent, il est provoqué par une affection chronique sous-jacente, par exemple l’athérosclérose (calcification des artères ou rétrécissement progressif d’une artère dû à l’accumulation de graisse et d’autres substances) ou des troubles du rythme cardiaque. Il est donc important de prévoir un suivi médical régulier après un accident vasculaire cérébral. Ce suivi permet de réduire le risque de nouvel AVC.
Les différents types d’AVC
Il existe deux types d’AVC : ischémique et hémorragique. Il y a aussi l’accident ischémique transitoire (AIT) qui, techniquement, n’est pas un AVC mais un avertissement sérieux qu’un AVC pourrait survenir.
AVC ischémique
Un AVC ischémique survient lorsqu’un caillot bloque l’apport en sang et en oxygène vers une partie du cerveau.
- Si ce caillot se forme dans les vaisseaux sanguins du cerveau, on parle de thrombose cérébrale.
- On parle d'embolie cérébrale lorsque le caillot se forme ailleurs, dans le cœur par exemple, et se déplace vers le cerveau.
Près de 80 % des AVC sont des AVC ischémiques.
AVC hémorragique
Un AVC hémorragique survient lorsqu’un vaisseau sanguin dans le cerveau se rompt ou éclate, ce qui provoque un écoulement de sang dans ou autour du cerveau. Il y a alors une compression de la partie du cerveau autour de l’hémorragie, ce qui provoque des symptômes neurologiques sévères. La nature exacte de ces symptômes dépend de l’emplacement et de l’importance de l’hémorragie. Plus elle s’étend, et plus la pression sur le cerveau augmente, plus les symptômes peuvent s’aggraver au cours des premiers jours.
Près de 20 % des AVC sont provoqués par une hémorragie cérébrale. L’AVC hémorragique est donc beaucoup moins fréquent que l’AVC ischémique.
Accident ischémique transitoire (AIT)
Il existe aussi l’accident ischémique transitoire (AIT), également appelé mini-AVC ou AVC temporaire. C’est une obstruction temporaire de l’apport sanguin à une partie du cerveau. La conséquence est un manque d’oxygène pendant un court moment et des symptômes semblables à ceux d’un véritable AVC peuvent survenir. Dans la plupart des cas, l’apport sanguin se rétablit spontanément après quelques minutes et il n’y a pas de dommage permanent.
Vers le haut de la pageQuels sont les symptômes d’un AVC?
Les symptômes d’un accident vasculaire cérébral peuvent varier en fonction de la localisation et de l’importance de l’hémorragie ou de l’infarctus cérébral. Les signaux possibles sont :
- Paralysie soudaine d’un bras et / ou d’une jambe, généralement d’un seul côté.
- Bouche de travers (perte de force dans les muscles faciaux).
- Incapacité à parler ou difficulté à comprendre les mots (trouble du langage ou aphasie).
- Picotements ou troubles sensoriels.
- Cécité (partielle ou totale) subite ou vision double.
- Troubles de l’équilibre et vertiges (difficultés à marcher, démarche chancelante).
- Problèmes de coordination d’un bras et / ou d’une jambe.
- Maux de tête soudains et violents (« céphalées en coup de tonnerre »), accompagnés ou pas de nausées, de vomissements et / ou d’une perte de connaissance.
- Confusion soudaine.
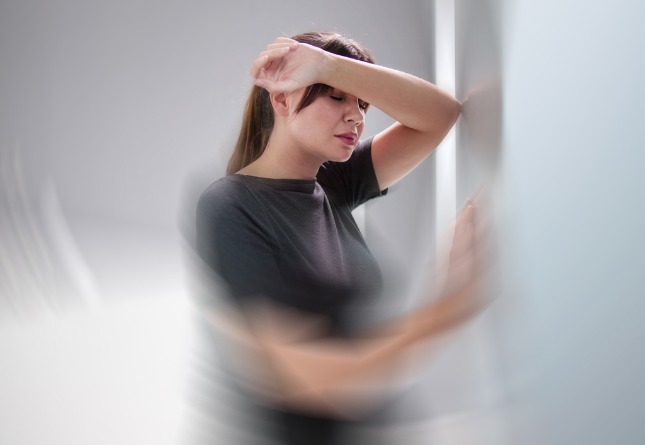
L’acronyme ”FAST“ est un moyen pratique de se souvenir de quelques symptômes fréquents :
• F = Face (visage) : affaissé ou de travers.
• A = Arm (bras) : faiblesse ou perte de force dans un bras.
• S = Speech (parole) : difficultés d’élocution.
• T = Time (temps) : cela vous rappelle l’importance d’agir rapidement. Formez immédiatement le numéro 112 en cas d’apparition d’un des symptômes décrits ci-dessus. Il est aussi important que les ambulanciers sachent à quelle heure les symptômes sont apparus. C’est une information importante pour le choix du traitement le plus approprié.
Certaines personnes utilisent aujourd’hui l’acronyme BE-FAST pour reconnaître encore plus facilement les AVC. B (balance en anglais), c’est l’équilibre, cette lettre fait allusion à une perte d’équilibre. E (eyes), ce sont les yeux, et donc les troubles de la vue. Des études indiquent toutefois que le simple terme FAST est généralement mieux mémorisé.
Sachez aussi qu’un AVC ne provoque pas toujours ces symptômes typiques. Parfois, les signes sont moins typiques : nausées, vomissements, vertiges, changements de conscience. Dans de très rares cas, les vertiges sont même l’unique symptôme.
Parfois, un accident ischémique transitoire survient, avec les mêmes symptômes, mais ils disparaissent rapidement, généralement après quelques minutes à quelques heures. C’est toujours un signal d’alarme très grave : près de 10 % des personnes victimes d’un AIT font un véritable AVC dans la semaine qui suit, et 10 à 20 % dans les trois mois. En cas d’AIT, rendez-vous donc immédiatement à l’hôpital.
Comment diagnostique-t-on un AVC ?
Le médecin recueille des informations sur les symptômes spécifiques du patient, le moment de leur apparition et les antécédents médicaux du patient. Il pose notamment ces questions :
- Le patient a-t-il fait récemment un AVC ou une crise cardiaque ?
- A-t-il souffert d'épilepsie ou convulsions.
- A-t-il subi des opérations récentes.
- Consommation de drogues.
- Prend-il des médicaments (tels que des anticoagulants, de l’insuline ou des hypotenseurs).
Il réalise aussi des tests physiques et verbaux destinés à évaluer le fonctionnement du cerveau. Par exemple : « Décrivez cette image », « Montrez vos dents » ou « Fermez les yeux et serrez le poing. »
D’autres examens sont réalisés à l’hôpital grâce à des techniques d’imagerie médicale : électrocardiogramme, échographie Doppler, scanner ou IRM du cerveau. Un scanner au résultat normal n’exclut pas un AVC ischémique, surtout dans les premières heures. En revanche, il est fort peu probable que le résultat de l’IRM soit normal si le patient a bel et bien subi un AVC.

Des analyses de sang font souvent partie du diagnostic également quand il y a suspicion d’AVC. Elles permettent d’exclure des facteurs de risque comme l’hypoglycémie ou l’hyperglycémie, et elles peuvent détecter des troubles sous-jacents, par exemple des troubles de la coagulation.
Vers le haut de la pageQuel traitement après un AVC?
Le traitement dépend du type d’AVC. Ainsi, le traitement d’un AVC ischémique est très différent du traitement d’une hémorragie cérébrale. Certains traitements destinés à dissoudre les caillots sanguins dans le cas d’un AVC ischémique peuvent par exemple aggraver une hémorragie cérébrale. Il est donc crucial que le corps médical détermine rapidement et précisément le type d’AVC avant de lancer un traitement.
En outre, l’expression « Time is brain », « Le temps, c’est le cerveau », montre l’importance d’une intervention rapide : plus le corps médical intervient rapidement, plus les chances d’obtenir un bon résultat sont élevées.
Le traitement d’un AIT
Dans la plupart des cas, les médecins prescrivent de l’aspirine à faible dose. Ce produit empêche les plaquettes sanguines de s’agglutiner et de former des caillots, ce qui diminue le risque de nouvelles obstructions dans les vaisseaux sanguins.
Si un examen montre un rétrécissement important de la carotide, une intervention chirurgicale peut être nécessaire pour la dilater. Il y a deux options:
L'endartériectomie carotidienne
Le chirurgien retire la plaque de la carotide en pratiquant une incision dans le cou. Cette intervention comporte des risques : hémorragie, infection, lésions nerveuses, ou accident vasculaire cérébral pendant l’opération.
Le stenting carotidien
C’est une alternative pour les personnes présentant un risque opératoire élevé ou si l’artère est difficile d’accès, ce qui rend l’opération dangereuse. À l’aide d’un fin cathéter inséré dans l’aine, le médecin introduit un stent (petite prothèse tubulaire) dans l’artère carotide vers le rétrécissement. Le stent maintient la carotide ouverte et rétablit ainsi l’irrigation sanguine vers le cerveau, ce qui réduit le risque d’AVC. Cette intervention comporte aussi des risques : un caillot sanguin dans la carotide peut se détacher et se diriger vers le cerveau, ce qui peut provoquer un accident vasculaire cérébral. Le risque est légèrement plus élevé que dans le cas d’une opération par le cou.
Les médecins peuvent aussi prescrire des médicaments pour traiter les affections sous-jacentes qui ont pu provoquer le rétrécissement : hypertension artérielle, hypercholestérolémie, diabète, troubles du rythme cardiaque. On vous fournira par ailleurs des conseils sur un mode de vie sain, par exemple arrêter le tabagisme ou faire davantage d’exercice physique.Un diagnostic rapide et un traitement préventif peuvent diminuer le risque d’accident vasculaire cérébral de 80 % dans les trois mois.
Les médecins peuvent aussi prescrire des médicaments pour traiter les affections sous-jacentes qui ont pu provoquer le rétrécissement : hypertension artérielle, hypercholestérolémie, diabète, troubles du rythme cardiaque. On vous fournira par ailleurs des conseils sur un mode de vie sain, par exemple arrêter le tabagisme ou faire davantage d’exercice physique.
Un diagnostic rapide et un traitement préventif peuvent diminuer le risque d’accident vasculaire cérébral de 80 % dans les trois mois.
Le traitement d’un AVC ischémique
Durant les premières heures qui suivent un AVC, il est crucial d’agir rapidement pour limiter les lésions cérébrales. Les principaux traitements sont la thrombolyse et la thrombectomie.
Thrombolyse
Si le patient arrive très vite à l’hôpital (dans les heures qui suivent l’AVC), un anticoagulant puissant (tPA) peut lui être administré par voie intraveineuse. Ce produit aide à dissoudre le caillot sanguin et rétablit l’irrigation sanguine vers le cerveau. Les médecins doivent s’assurer au préalable que le patient ne présente pas d’hémorragie cérébrale car la thrombolyse risque d’aggraver les hémorragies.
Une hémorragie cérébrale survenue au cours des trois derniers mois, un accident vasculaire cérébral ischémique ou une intervention chirurgicale majeure au cours des deux derniers mois sont aussi des contre-indications.
Pour éviter des lésions irréversibles du tissu cérébral, il est important de commencer le traitement le plus rapidement possible, certainement dans la demi-heure qui suit l’admission à l’hôpital.

Thrombectomie
Si le caillot est trop volumineux pour être éliminé via une thrombolyse, il peut être enlevé via une intervention chirurgicale. Le chirurgien insère un petit tube dans l’aine pour retirer le caillot et rétablir la circulation sanguine. Environ 5 à 10 % des patients victimes d’un infarctus cérébral peuvent bénéficier de ce type d’intervention.
Ces traitements ne sont malheureusement pas toujours possibles. Souvent, les patients arrivent trop tard à l’hôpital, ou les risques de l’intervention sont supérieurs aux avantages potentiels. Ils reçoivent alors souvent des anticoagulants oraux, généralement de l’acide acétylsalicylique (aspirine) à faible dose pour diminuer le risque de nouveaux caillots sanguins.
Médicaments pour les affections sous-jacentes
Le médecin peut aussi prescrire des médicaments pour traiter les affections sous-jacentes qui ont pu contribuer au déclenchement de l’AVC : hypertension artérielle, hypercholestérolémie, diabète, arythmie cardiaque, etc.
Dès que le patient est stable, on peut envisager une intervention chirurgicale vasculaire pour élargir une carotide fortement rétrécie : endartériectomie carotidienne ou stenting carotidien (voir plus haut).
Le traitement d’une hémorragie cérébrale
En cas d’hémorragie cérébrale, le saignement s’arrête généralement de lui-même car le corps utilise son propre processus de coagulation. Le crâne, dur, y contribue aussi. L’espace limité freine le saignement.
Il peut arriver que cet arrêt naturel du saignement soit retardé, par exemple par :
- Des anticoagulants: ils compliquent la coagulation.
- L’hypertension artérielle incontrôlée: une pression artérielle trop élevée peut prolonger le saignement.
Il est donc important de traiter sans délai ces deux facteurs :
- La pression artérielle doit être contrôlée le plus rapidement possible.
- L’utilisation d’anticoagulants doit être stoppée immédiatement. Tous les anticoagulants et les médicaments antiplaquettaires doivent être arrêtés. Si nécessaire, on administre des médicaments pour neutraliser l’effet des anticoagulants.
Dans certains cas, lorsque les saignements et les symptômes s’aggravent, une intervention chirurgicale s’impose pour retirer le sang du cerveau.
Vers le haut de la pageComment se rétablir après un AVC?
Les suites d’un accident vasculaire cérébral sont difficilement prévisibles. Voici ce que disent les chiffres de BMJ Best Practice :
- Environ 15 personnes sur 100 victimes d’un AVC décèdent dans les 30 jours. Ce premier mois est celui qui présente le plus de risques.
- Plus de la moitié des patients se rétablissent bien et peuvent à nouveau prendre soin d’eux-mêmes.
- Environ deux tiers des personnes victimes d’un AVC présentent une forme de handicap lorsqu’elles sortent de l’hôpital. Certaines séquelles sont permanentes.
- Environ 25 patients sur 100 sont victimes d’un nouvel AVC dans les cinq ans.
Problèmes courants à long terme après un AVC
Problèmes de langage
Faiblesse et troubles moteurs
Perte partielle de sensibilité
Certaines personnes perdent partiellement ou entièrement la sensibilité d’un côté du corps.
Problèmes pour manger ou avaler
Il peut être difficile d’avaler après un AVC. C’est la dysphagie. Il arrive que la nourriture passe dans le mauvais sens et atteigne les poumons. C’est dangereux et cela peut provoquer des infections pulmonaires, par exemple une pneumonie. Certains patients doivent avoir recours temporairement à une sonde d’alimentation, d’autres peuvent adapter leurs habitudes en matière d’alimentation et de boisson.
Problèmes de lucidité ou de relation avec les autres
Les personnes qui ont été victimes d’un accident vasculaire cérébral peuvent être facilement désorientées ou rencontrer des difficultés pour se concentrer. Les modifications de comportement sont fréquentes et les personnes se comportent différemment d’avant l’AVC.
Fatigue physique et mentale
La fatigue après un AVC est un symptôme fréquent. Les personnes se sentent souvent fatiguées ou apathiques, et le repos ne solutionne généralement pas le problème.
La fatigue peut être physique (monter les escaliers ou aller de la cuisine à la chambre à coucher peut s’apparenter à un défi) ou mentale (perte de la mémoire à court terme, esprit confus ou oublis). Chez certains patients, c’est si grave que cela entrave sérieusement leur vie quotidienne.
Dépression et anxiété
Les symptômes de dépression et d’anxiété sont fréquents après un AVC et ils peuvent compliquer le rétablissement.
Problèmes de contrôle de la vessie
Certains patients ne peuvent plus contrôler correctement leur vessie ou ont des fuites urinaires. C’est l’incontinence urinaire. Dans la plupart des cas, ces symptômes diminuent spontanément avec le temps.
Séjour à l’hôpital après un AVC
Après les premiers soins prodigués au service des urgences, le patient est idéalement admis dans un service spécialisé dans le traitement des AVC. Des études montrent qu’une hospitalisation dans un service spécialisé augmente les chances de survie et diminue le risque de séquelles permanentes. Les patients y sont surveillés 24h/24. Leur état neurologique, leur rythme cardiaque, leur tension artérielle et leurs problèmes éventuels de déglutition et de respiration sont étroitement surveillés.
Un séjour dans ce type de service dure généralement quelques jours. Aussi longtemps que les patients ne sont pas entièrement stabilisés, ils restent à l’hôpital.
Il y a ensuite différentes options. Soit le patient rentre chez lui et suit une thérapie de jour, soit il est orienté vers un centre de rééducation spécialisé. S’il n’y a pas de place disponible, une solution alternative est recherchée.
L’importance de la rééducation après un AVC
Des traitements comme la thrombolyse et la thrombectomie sont essentiels pour diminuer les conséquences d’un AVC en rétablissant la circulation sanguine et en limitant les lésions cérébrales.
Mais le traitement ne s’arrête pas là. La rééducation est au moins aussi importante. Elle permet au patient de récupérer ses fonctions, de s’adapter à ses limitations permanentes et d’améliorer petit à petit sa qualité de vie.

Sur quels aspects se concentre la rééducation?
La rééducation peut avoir des objectifs très variés. En fonction des symptômes, ces objectifs peuvent être :
- Bouger le mieux possible: travailler la mobilité, l’équilibre et la force.
- Utiliser les bras et les mains: améliorer la coordination et la force dans les activités quotidiennes.
- Prendre soin de soi: pouvoir se laver, s’habiller et accomplir d’autres tâches personnelles.
- Communication et contact social: parler, comprendre et entretenir des contacts avec les autres.
- Tâches ménagères: cuisiner, nettoyer, faire les courses et accomplir d’autres tâches pratiques.
- Loisirs et temps libre: faire des choses que l’on aime.
- Gérer les défis cognitifs: apprendre à gérer les troubles de l’attention, de la mémoire et de la concentration.
- Gérer ses émotions: gérer la tristesse, la frustration et leur impact sur le patient et ses proches.
- Retour au travail: reprendre le travail ou faire du bénévolat.
La rééducation est un travail d’équipe
La rééducation n’est pas la tâche d’une seule personne. Plusieurs professionnels de la santé collaborent pour apporter un soutien optimal au patient :
- Kinésithérapeute: aide à faire pratiquer des exercices physiques.
- Logopède: aide à faire des exercices pour parler et avaler.
- Ergothérapeute: cherche des solutions pour que le patient puisse continuer à pratiquer des activités quotidiennes de façon autonome, par exemple s’habiller et cuisiner.
- Psychologue: aide le patient à comprendre et gérer les changements dans la pensée, la mémoire, l’attention et les émotions. Il propose éventuellement des stratégies pour relever ces défis au quotidien.
Plusieurs hôpitaux en Belgique disposent aussi d’un coach spécialisé dans le traitement des AVC. Il accompagne les patients depuis leur admission à l’hôpital jusqu’à six mois, voire un an plus tard. Il ne propose pas seulement un soutien pratique et émotionnel, il fournit également des informations pour que les patients comprennent mieux leur maladie et apprennent à l’accepter.
Conseils pratiques pour un bon rétablissement

Commencer dès que possible
Dès que le patient est stable d’un point de vue médical, il est conseillé de commencer la rééducation immédiatement à l’hôpital. Les directives recommandent d’entamer la mobilisation dans les 48 heures, par exemple en aidant le patient à s’asseoir, à se lever ou à marcher, pour autant que ces exercices ne présentent pas de risque médical. Il ne faut pas commencer la rééducation avant 24 heures car cela pourrait être contre-productif.
S’adapter au patient
La rééducation doit être adaptée aux limitations, aux besoins et aux objectifs spécifiques de chaque patient. Au cours des premiers jours, le focus est souvent mis sur une mobilisation rapide. Ensuite sur l’autonomie à domicile, la reprise du travail et la gestion des limitations permanentes. Des aides ou des techniques de compensation sont parfois nécessaires, par exemple apprendre à écrire avec l’autre main ou porter des chaussures adaptées si le patient n’est plus en mesure de faire ses lacets.
Suffisamment intense et fréquent
Plus les patients travaillent souvent et régulièrement à leur rééducation, plus la guérison s’accélère. Des directives internationales recommandent des exercices quotidiens, au moins trois heures par jour, au moins cinq jours par semaine, et une combinaison de kinésithérapie, ergothérapie et logopédie.
Un processus de longue haleine
Le rétablissement ne s’arrête pas à la fin de l’hospitalisation. Souvent, il y a dans un premier temps une thérapie ambulatoire. Il est parfois nécessaire de passer par un centre de rééducation. Les progrès se font par petites étapes : ils sont rapides au début, ensuite plus lents. Mais une amélioration est possible jusqu’à environ un an après l’accident vasculaire cérébral.
Le rôle essentiel de la famille et des aidants
Ils apportent un soutien émotionnel et de la motivation, ils aident dans les activités de la vie quotidienne, ils administrent les médicaments et ils soutiennent les changements dans le mode de vie pour prévenir un nouvel AVC.
Leur implication permet au patient de rester actif et motivé pendant sa rééducation et elle peut améliorer sensiblement les résultats. En outre, les aidants font office de porte-parole auprès des prestataires de soins de santé et ils veillent aux intérêts du patient.
Comment prévenir un AVC?
Personne n’est à l’abri d’un AVC mais le risque augmente avec l’âge. Et si vous ne pouvez pas changer votre âge, vous pouvez modifier votre mode de vie, et cela peut faire une grande différence. Si vous présentez un risque élevé, vous devrez parfois prendre des médicaments.
Si vous avez déjà été victime d’un AVC, le corps médical parle de « prévention secondaire » : prévenir un nouvel accident vasculaire cérébral.
L’importance d’un mode de vie sain
Presque toutes les directives médicales se rejoignent pour affirmer qu’un mode de vie sain est la clé pour réduire le risque d’AVC (et d’autres maladies cardiovasculaires). Voici les principaux piliers :
1. Ne pas fumer
Le tabagisme est l’un des principaux facteurs de risque. Plus vous fumez, plus le risque d’AVC est élevé. Dans une étude impliquant des personnes suivies pendant sept ans et demi en moyenne, les fumeurs victimes d’un AVC avaient 2,27 fois plus de risques de décéder que les patients n’ayant jamais fumé. En d’autres termes, le tabagisme augmente considérablement le risque de décès à la suite d’un accident vasculaire cérébral.
Bonne nouvelle : il est bénéfique d'arrêter de fumer à tout âge. Des études montrent que cinq ans après avoir fumé votre dernière cigarette, votre risque de développer une maladie cardiovasculaire est presque aussi faible que celui d'une personne qui n'a jamais fumé.
2. Bouger suffisamment
L’activité physique est un pur bienfait pour la santé. Selon des études, les personnes très actives ont 27 % de risques en moins d’être victimes d’un AVC que des personnes qui ne font pratiquement pas d’exercice physique. Même une activité physique modérée diminue déjà le risque de 20 %.
3. Limiter la consommation d’alcool
Un verre est autorisé mais il faut consommer l’alcool avec modération. Une consommation quotidienne augmente le risque d’hémorragie cérébrale. Pour les AVC ischémiques, le risque le plus faible correspond à un seul verre par jour. À partir de trois verres, le risque d’AVC ischémique et de décès augmente fortement, aussi bien chez les femmes que chez les hommes. Il est possible que l’effet hypertenseur de l’alcool joue un rôle important.
4. Surveiller son poids
Les personnes en surpoids (avec un IMC de 25 à 29,9) ont 22 % de risques en plus d’être victimes d’un AVC ischémique. En cas d’obésité (IMC supérieur à 30), le risque passe à 64 %. Essayez donc de maintenir un poids sain ou de perdre quelques kilos si vous êtes en surpoids. Même s’il n’y a pas de lien clairement établi entre le surpoids ou l’obésité et le risque d’hémorragie cérébrale.
5. Manger sain et équilibré
L’American Heart Association (AHA) recommande un régime méditerranéen pour diminuer le risque d’AVC. Pour en savoir plus, cliquez ici. Ou privilégiez simplement une alimentation saine.
Les médicaments pour réduire le risque d’AVC
Parfois, un mode de vie sain ne suffit pas. Les personnes présentant un risque (très) élevé d’AVC (ou de crise cardiaque) doivent souvent prendre des médicaments comme des hypotenseurs, des hypocholestérolémiants (des statines dans la majorité des cas) ou des anticoagulants.
Un risque élevé d’AVC dépend de différents facteurs. Votre médecin peut évaluer votre risque en pratiquant le test STROKE-2. Certaines personnes présentent un risque (très) élevé d’accident vasculaire cérébral, par exemple :
- Les patients qui ont déjà subi un AIT ou un AVC.
- Les patients qui présentent d’autres troubles cardiovasculaires dus à l’athérosclérose.
- Les personnes qui souffrent de diabète de type 2 depuis plus de dix ans.
- Les personnes qui souffrent de diabète de type 2 et dont la glycémie est mal contrôlée.
- Les personnes atteintes d’insuffisance rénale chronique.
- Les personnes souffrant d’hypertension artérielle significative.
- Les personnes qui souffrent d’hypercholestérolémie familiale.
Bon à savoir aussi
- Contraception et hormonothérapie: si vous avez été victime d’un accident ischémique transitoire (AIT) ou d’un accident vasculaire cérébral, les contraceptifs contenant des œstrogènes et les traitements hormonaux contenant des œstrogènes pour les symptômes de la ménopause sont déconseillés.
- Apnée du sommeil: le syndrome d’apnées obstructives du sommeil (SAOS) sévère multiplie par deux le risque d’AVC, en particulier chez les personnes jeunes et d’âge moyen. La ventilation en pression positive continue (PPC) peut réduire le risque d’AVC, en particulier chez les patients qui suivent scrupuleusement leur traitement.
Conclusion : Que faut-il retenir au sujet des AVC?
Un AVC peut survenir subitement et constitue dans tous les cas une urgence médicale. Agir rapidement est crucial : appelez immédiatement le 112 et notez l’heure à laquelle les premiers symptômes sont apparus.
- Soyez attentif à toutes les manifestations: le visage de travers, l’impossibilité de lever un bras ou des troubles de l’élocution sont des signes avant-coureurs. Un mini AVC (IAT) est aussi un signe avant-coureur sérieux, même si les symptômes disparaissent rapidement.
- Le traitement dépend du type d’AVC: dans le cas d’un AVC ischémique, une thrombolyse ou une thrombectomie peut sauver la vie. Dans le cas d’un AVC hémorragique, le focus est mis sur la stabilisation et le contrôle des séquelles.
- La rééducation est essentielle: une thérapie commencée rapidement, intensive et ciblée aide le patient à récupérer ses fonctions et son autonomie. La famille et les aidants jouent un grand rôle.
- La prévention est importante: un mode de vie sain et une bonne gestion de la tension artérielle, du cholestérol et du diabète sont importants. Il est parfois nécessaire de prendre des médicaments comme des hypotenseurs, des statines ou des anticoagulants. Des visites régulières chez le médecin généraliste ou un spécialiste peuvent éviter la prise de médicaments.
Pour résumer : un accident vasculaire cérébral nécessite une intervention rapide, un traitement adapté et une rééducation ciblée, avec le soutien de la famille et du personnel soignant. Chaque minute compte et augmente les chances de guérison et de retrouver une vie aussi normale que possible.
Vers le haut de la pageUn AVC (accident vasculaire cérébral) survient lorsqu’un problème se produit dans un vaisseau sanguin du cerveau. Un vaisseau sanguin peut se boucher ou se rompre. Des cellules cérébrales cessent alors subitement de fonctionner. Souvent, des symptômes clairs apparaissent immédiatement : bras ou jambe paralysé, bouche de travers, difficulté à voir, parler ou avaler. Les médecins parlent de déficience neurologique ou de perte de fonction.
Dans la plupart des cas, un AVC survient de manière inattendue. Mais souvent, il est provoqué par une affection chronique sous-jacente, par exemple l’athérosclérose (calcification des artères ou rétrécissement progressif d’une artère dû à l’accumulation de graisse et d’autres substances) ou des troubles du rythme cardiaque. Il est donc important de prévoir un suivi médical régulier après un accident vasculaire cérébral. Ce suivi permet de réduire le risque de nouvel AVC.
Les différents types d’AVC
Il existe deux types d’AVC : ischémique et hémorragique. Il y a aussi l’accident ischémique transitoire (AIT) qui, techniquement, n’est pas un AVC mais un avertissement sérieux qu’un AVC pourrait survenir.
AVC ischémique
Un AVC ischémique survient lorsqu’un caillot bloque l’apport en sang et en oxygène vers une partie du cerveau.
- Si ce caillot se forme dans les vaisseaux sanguins du cerveau, on parle de thrombose cérébrale.
- On parle d'embolie cérébrale lorsque le caillot se forme ailleurs, dans le cœur par exemple, et se déplace vers le cerveau.
Près de 80 % des AVC sont des AVC ischémiques.
AVC hémorragique
Un AVC hémorragique survient lorsqu’un vaisseau sanguin dans le cerveau se rompt ou éclate, ce qui provoque un écoulement de sang dans ou autour du cerveau. Il y a alors une compression de la partie du cerveau autour de l’hémorragie, ce qui provoque des symptômes neurologiques sévères. La nature exacte de ces symptômes dépend de l’emplacement et de l’importance de l’hémorragie. Plus elle s’étend, et plus la pression sur le cerveau augmente, plus les symptômes peuvent s’aggraver au cours des premiers jours.
Près de 20 % des AVC sont provoqués par une hémorragie cérébrale. L’AVC hémorragique est donc beaucoup moins fréquent que l’AVC ischémique.
Accident ischémique transitoire (AIT)
Il existe aussi l’accident ischémique transitoire (AIT), également appelé mini-AVC ou AVC temporaire. C’est une obstruction temporaire de l’apport sanguin à une partie du cerveau. La conséquence est un manque d’oxygène pendant un court moment et des symptômes semblables à ceux d’un véritable AVC peuvent survenir. Dans la plupart des cas, l’apport sanguin se rétablit spontanément après quelques minutes et il n’y a pas de dommage permanent.
Les symptômes d’un accident vasculaire cérébral peuvent varier en fonction de la localisation et de l’importance de l’hémorragie ou de l’infarctus cérébral. Les signaux possibles sont :
- Paralysie soudaine d’un bras et / ou d’une jambe, généralement d’un seul côté.
- Bouche de travers (perte de force dans les muscles faciaux).
- Incapacité à parler ou difficulté à comprendre les mots (trouble du langage ou aphasie).
- Picotements ou troubles sensoriels.
- Cécité (partielle ou totale) subite ou vision double.
- Troubles de l’équilibre et vertiges (difficultés à marcher, démarche chancelante).
- Problèmes de coordination d’un bras et / ou d’une jambe.
- Maux de tête soudains et violents (« céphalées en coup de tonnerre »), accompagnés ou pas de nausées, de vomissements et / ou d’une perte de connaissance.
- Confusion soudaine.
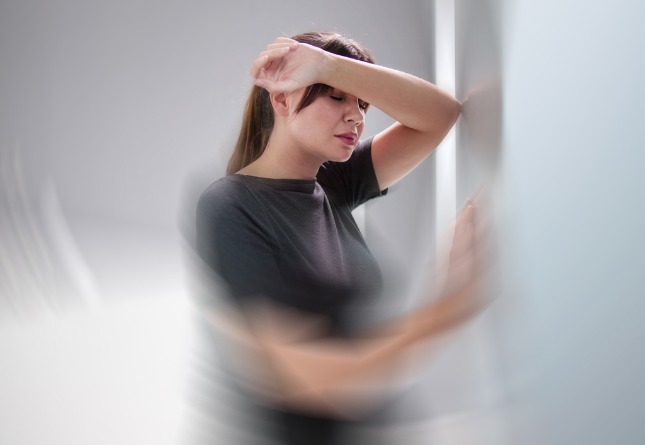
L’acronyme ”FAST“ est un moyen pratique de se souvenir de quelques symptômes fréquents :
• F = Face (visage) : affaissé ou de travers.
• A = Arm (bras) : faiblesse ou perte de force dans un bras.
• S = Speech (parole) : difficultés d’élocution.
• T = Time (temps) : cela vous rappelle l’importance d’agir rapidement. Formez immédiatement le numéro 112 en cas d’apparition d’un des symptômes décrits ci-dessus. Il est aussi important que les ambulanciers sachent à quelle heure les symptômes sont apparus. C’est une information importante pour le choix du traitement le plus approprié.
Certaines personnes utilisent aujourd’hui l’acronyme BE-FAST pour reconnaître encore plus facilement les AVC. B (balance en anglais), c’est l’équilibre, cette lettre fait allusion à une perte d’équilibre. E (eyes), ce sont les yeux, et donc les troubles de la vue. Des études indiquent toutefois que le simple terme FAST est généralement mieux mémorisé.
Sachez aussi qu’un AVC ne provoque pas toujours ces symptômes typiques. Parfois, les signes sont moins typiques : nausées, vomissements, vertiges, changements de conscience. Dans de très rares cas, les vertiges sont même l’unique symptôme.
Parfois, un accident ischémique transitoire survient, avec les mêmes symptômes, mais ils disparaissent rapidement, généralement après quelques minutes à quelques heures. C’est toujours un signal d’alarme très grave : près de 10 % des personnes victimes d’un AIT font un véritable AVC dans la semaine qui suit, et 10 à 20 % dans les trois mois. En cas d’AIT, rendez-vous donc immédiatement à l’hôpital.
Le médecin recueille des informations sur les symptômes spécifiques du patient, le moment de leur apparition et les antécédents médicaux du patient. Il pose notamment ces questions :
- Le patient a-t-il fait récemment un AVC ou une crise cardiaque ?
- A-t-il souffert d'épilepsie ou convulsions.
- A-t-il subi des opérations récentes.
- Consommation de drogues.
- Prend-il des médicaments (tels que des anticoagulants, de l’insuline ou des hypotenseurs).
Il réalise aussi des tests physiques et verbaux destinés à évaluer le fonctionnement du cerveau. Par exemple : « Décrivez cette image », « Montrez vos dents » ou « Fermez les yeux et serrez le poing. »
D’autres examens sont réalisés à l’hôpital grâce à des techniques d’imagerie médicale : électrocardiogramme, échographie Doppler, scanner ou IRM du cerveau. Un scanner au résultat normal n’exclut pas un AVC ischémique, surtout dans les premières heures. En revanche, il est fort peu probable que le résultat de l’IRM soit normal si le patient a bel et bien subi un AVC.

Des analyses de sang font souvent partie du diagnostic également quand il y a suspicion d’AVC. Elles permettent d’exclure des facteurs de risque comme l’hypoglycémie ou l’hyperglycémie, et elles peuvent détecter des troubles sous-jacents, par exemple des troubles de la coagulation.
Le traitement dépend du type d’AVC. Ainsi, le traitement d’un AVC ischémique est très différent du traitement d’une hémorragie cérébrale. Certains traitements destinés à dissoudre les caillots sanguins dans le cas d’un AVC ischémique peuvent par exemple aggraver une hémorragie cérébrale. Il est donc crucial que le corps médical détermine rapidement et précisément le type d’AVC avant de lancer un traitement.
En outre, l’expression « Time is brain », « Le temps, c’est le cerveau », montre l’importance d’une intervention rapide : plus le corps médical intervient rapidement, plus les chances d’obtenir un bon résultat sont élevées.
Le traitement d’un AIT
Dans la plupart des cas, les médecins prescrivent de l’aspirine à faible dose. Ce produit empêche les plaquettes sanguines de s’agglutiner et de former des caillots, ce qui diminue le risque de nouvelles obstructions dans les vaisseaux sanguins.
Si un examen montre un rétrécissement important de la carotide, une intervention chirurgicale peut être nécessaire pour la dilater. Il y a deux options:
L'endartériectomie carotidienne
Le chirurgien retire la plaque de la carotide en pratiquant une incision dans le cou. Cette intervention comporte des risques : hémorragie, infection, lésions nerveuses, ou accident vasculaire cérébral pendant l’opération.
Le stenting carotidien
C’est une alternative pour les personnes présentant un risque opératoire élevé ou si l’artère est difficile d’accès, ce qui rend l’opération dangereuse. À l’aide d’un fin cathéter inséré dans l’aine, le médecin introduit un stent (petite prothèse tubulaire) dans l’artère carotide vers le rétrécissement. Le stent maintient la carotide ouverte et rétablit ainsi l’irrigation sanguine vers le cerveau, ce qui réduit le risque d’AVC. Cette intervention comporte aussi des risques : un caillot sanguin dans la carotide peut se détacher et se diriger vers le cerveau, ce qui peut provoquer un accident vasculaire cérébral. Le risque est légèrement plus élevé que dans le cas d’une opération par le cou.
Les médecins peuvent aussi prescrire des médicaments pour traiter les affections sous-jacentes qui ont pu provoquer le rétrécissement : hypertension artérielle, hypercholestérolémie, diabète, troubles du rythme cardiaque. On vous fournira par ailleurs des conseils sur un mode de vie sain, par exemple arrêter le tabagisme ou faire davantage d’exercice physique.Un diagnostic rapide et un traitement préventif peuvent diminuer le risque d’accident vasculaire cérébral de 80 % dans les trois mois.
Les médecins peuvent aussi prescrire des médicaments pour traiter les affections sous-jacentes qui ont pu provoquer le rétrécissement : hypertension artérielle, hypercholestérolémie, diabète, troubles du rythme cardiaque. On vous fournira par ailleurs des conseils sur un mode de vie sain, par exemple arrêter le tabagisme ou faire davantage d’exercice physique.
Un diagnostic rapide et un traitement préventif peuvent diminuer le risque d’accident vasculaire cérébral de 80 % dans les trois mois.
Le traitement d’un AVC ischémique
Durant les premières heures qui suivent un AVC, il est crucial d’agir rapidement pour limiter les lésions cérébrales. Les principaux traitements sont la thrombolyse et la thrombectomie.
Thrombolyse
Si le patient arrive très vite à l’hôpital (dans les heures qui suivent l’AVC), un anticoagulant puissant (tPA) peut lui être administré par voie intraveineuse. Ce produit aide à dissoudre le caillot sanguin et rétablit l’irrigation sanguine vers le cerveau. Les médecins doivent s’assurer au préalable que le patient ne présente pas d’hémorragie cérébrale car la thrombolyse risque d’aggraver les hémorragies.
Une hémorragie cérébrale survenue au cours des trois derniers mois, un accident vasculaire cérébral ischémique ou une intervention chirurgicale majeure au cours des deux derniers mois sont aussi des contre-indications.
Pour éviter des lésions irréversibles du tissu cérébral, il est important de commencer le traitement le plus rapidement possible, certainement dans la demi-heure qui suit l’admission à l’hôpital.

Thrombectomie
Si le caillot est trop volumineux pour être éliminé via une thrombolyse, il peut être enlevé via une intervention chirurgicale. Le chirurgien insère un petit tube dans l’aine pour retirer le caillot et rétablir la circulation sanguine. Environ 5 à 10 % des patients victimes d’un infarctus cérébral peuvent bénéficier de ce type d’intervention.
Ces traitements ne sont malheureusement pas toujours possibles. Souvent, les patients arrivent trop tard à l’hôpital, ou les risques de l’intervention sont supérieurs aux avantages potentiels. Ils reçoivent alors souvent des anticoagulants oraux, généralement de l’acide acétylsalicylique (aspirine) à faible dose pour diminuer le risque de nouveaux caillots sanguins.
Médicaments pour les affections sous-jacentes
Le médecin peut aussi prescrire des médicaments pour traiter les affections sous-jacentes qui ont pu contribuer au déclenchement de l’AVC : hypertension artérielle, hypercholestérolémie, diabète, arythmie cardiaque, etc.
Dès que le patient est stable, on peut envisager une intervention chirurgicale vasculaire pour élargir une carotide fortement rétrécie : endartériectomie carotidienne ou stenting carotidien (voir plus haut).
Le traitement d’une hémorragie cérébrale
En cas d’hémorragie cérébrale, le saignement s’arrête généralement de lui-même car le corps utilise son propre processus de coagulation. Le crâne, dur, y contribue aussi. L’espace limité freine le saignement.
Il peut arriver que cet arrêt naturel du saignement soit retardé, par exemple par :
- Des anticoagulants: ils compliquent la coagulation.
- L’hypertension artérielle incontrôlée: une pression artérielle trop élevée peut prolonger le saignement.
Il est donc important de traiter sans délai ces deux facteurs :
- La pression artérielle doit être contrôlée le plus rapidement possible.
- L’utilisation d’anticoagulants doit être stoppée immédiatement. Tous les anticoagulants et les médicaments antiplaquettaires doivent être arrêtés. Si nécessaire, on administre des médicaments pour neutraliser l’effet des anticoagulants.
Dans certains cas, lorsque les saignements et les symptômes s’aggravent, une intervention chirurgicale s’impose pour retirer le sang du cerveau.
Les suites d’un accident vasculaire cérébral sont difficilement prévisibles. Voici ce que disent les chiffres de BMJ Best Practice :
- Environ 15 personnes sur 100 victimes d’un AVC décèdent dans les 30 jours. Ce premier mois est celui qui présente le plus de risques.
- Plus de la moitié des patients se rétablissent bien et peuvent à nouveau prendre soin d’eux-mêmes.
- Environ deux tiers des personnes victimes d’un AVC présentent une forme de handicap lorsqu’elles sortent de l’hôpital. Certaines séquelles sont permanentes.
- Environ 25 patients sur 100 sont victimes d’un nouvel AVC dans les cinq ans.
Problèmes courants à long terme après un AVC
Problèmes de langage
Faiblesse et troubles moteurs
Perte partielle de sensibilité
Certaines personnes perdent partiellement ou entièrement la sensibilité d’un côté du corps.
Problèmes pour manger ou avaler
Il peut être difficile d’avaler après un AVC. C’est la dysphagie. Il arrive que la nourriture passe dans le mauvais sens et atteigne les poumons. C’est dangereux et cela peut provoquer des infections pulmonaires, par exemple une pneumonie. Certains patients doivent avoir recours temporairement à une sonde d’alimentation, d’autres peuvent adapter leurs habitudes en matière d’alimentation et de boisson.
Problèmes de lucidité ou de relation avec les autres
Les personnes qui ont été victimes d’un accident vasculaire cérébral peuvent être facilement désorientées ou rencontrer des difficultés pour se concentrer. Les modifications de comportement sont fréquentes et les personnes se comportent différemment d’avant l’AVC.
Fatigue physique et mentale
La fatigue après un AVC est un symptôme fréquent. Les personnes se sentent souvent fatiguées ou apathiques, et le repos ne solutionne généralement pas le problème.
La fatigue peut être physique (monter les escaliers ou aller de la cuisine à la chambre à coucher peut s’apparenter à un défi) ou mentale (perte de la mémoire à court terme, esprit confus ou oublis). Chez certains patients, c’est si grave que cela entrave sérieusement leur vie quotidienne.
Dépression et anxiété
Les symptômes de dépression et d’anxiété sont fréquents après un AVC et ils peuvent compliquer le rétablissement.
Problèmes de contrôle de la vessie
Certains patients ne peuvent plus contrôler correctement leur vessie ou ont des fuites urinaires. C’est l’incontinence urinaire. Dans la plupart des cas, ces symptômes diminuent spontanément avec le temps.
Séjour à l’hôpital après un AVC
Après les premiers soins prodigués au service des urgences, le patient est idéalement admis dans un service spécialisé dans le traitement des AVC. Des études montrent qu’une hospitalisation dans un service spécialisé augmente les chances de survie et diminue le risque de séquelles permanentes. Les patients y sont surveillés 24h/24. Leur état neurologique, leur rythme cardiaque, leur tension artérielle et leurs problèmes éventuels de déglutition et de respiration sont étroitement surveillés.
Un séjour dans ce type de service dure généralement quelques jours. Aussi longtemps que les patients ne sont pas entièrement stabilisés, ils restent à l’hôpital.
Il y a ensuite différentes options. Soit le patient rentre chez lui et suit une thérapie de jour, soit il est orienté vers un centre de rééducation spécialisé. S’il n’y a pas de place disponible, une solution alternative est recherchée.
L’importance de la rééducation après un AVC
Des traitements comme la thrombolyse et la thrombectomie sont essentiels pour diminuer les conséquences d’un AVC en rétablissant la circulation sanguine et en limitant les lésions cérébrales.
Mais le traitement ne s’arrête pas là. La rééducation est au moins aussi importante. Elle permet au patient de récupérer ses fonctions, de s’adapter à ses limitations permanentes et d’améliorer petit à petit sa qualité de vie.

Sur quels aspects se concentre la rééducation?
La rééducation peut avoir des objectifs très variés. En fonction des symptômes, ces objectifs peuvent être :
- Bouger le mieux possible: travailler la mobilité, l’équilibre et la force.
- Utiliser les bras et les mains: améliorer la coordination et la force dans les activités quotidiennes.
- Prendre soin de soi: pouvoir se laver, s’habiller et accomplir d’autres tâches personnelles.
- Communication et contact social: parler, comprendre et entretenir des contacts avec les autres.
- Tâches ménagères: cuisiner, nettoyer, faire les courses et accomplir d’autres tâches pratiques.
- Loisirs et temps libre: faire des choses que l’on aime.
- Gérer les défis cognitifs: apprendre à gérer les troubles de l’attention, de la mémoire et de la concentration.
- Gérer ses émotions: gérer la tristesse, la frustration et leur impact sur le patient et ses proches.
- Retour au travail: reprendre le travail ou faire du bénévolat.
La rééducation est un travail d’équipe
La rééducation n’est pas la tâche d’une seule personne. Plusieurs professionnels de la santé collaborent pour apporter un soutien optimal au patient :
- Kinésithérapeute: aide à faire pratiquer des exercices physiques.
- Logopède: aide à faire des exercices pour parler et avaler.
- Ergothérapeute: cherche des solutions pour que le patient puisse continuer à pratiquer des activités quotidiennes de façon autonome, par exemple s’habiller et cuisiner.
- Psychologue: aide le patient à comprendre et gérer les changements dans la pensée, la mémoire, l’attention et les émotions. Il propose éventuellement des stratégies pour relever ces défis au quotidien.
Plusieurs hôpitaux en Belgique disposent aussi d’un coach spécialisé dans le traitement des AVC. Il accompagne les patients depuis leur admission à l’hôpital jusqu’à six mois, voire un an plus tard. Il ne propose pas seulement un soutien pratique et émotionnel, il fournit également des informations pour que les patients comprennent mieux leur maladie et apprennent à l’accepter.
Conseils pratiques pour un bon rétablissement

Commencer dès que possible
Dès que le patient est stable d’un point de vue médical, il est conseillé de commencer la rééducation immédiatement à l’hôpital. Les directives recommandent d’entamer la mobilisation dans les 48 heures, par exemple en aidant le patient à s’asseoir, à se lever ou à marcher, pour autant que ces exercices ne présentent pas de risque médical. Il ne faut pas commencer la rééducation avant 24 heures car cela pourrait être contre-productif.
S’adapter au patient
La rééducation doit être adaptée aux limitations, aux besoins et aux objectifs spécifiques de chaque patient. Au cours des premiers jours, le focus est souvent mis sur une mobilisation rapide. Ensuite sur l’autonomie à domicile, la reprise du travail et la gestion des limitations permanentes. Des aides ou des techniques de compensation sont parfois nécessaires, par exemple apprendre à écrire avec l’autre main ou porter des chaussures adaptées si le patient n’est plus en mesure de faire ses lacets.
Suffisamment intense et fréquent
Plus les patients travaillent souvent et régulièrement à leur rééducation, plus la guérison s’accélère. Des directives internationales recommandent des exercices quotidiens, au moins trois heures par jour, au moins cinq jours par semaine, et une combinaison de kinésithérapie, ergothérapie et logopédie.
Un processus de longue haleine
Le rétablissement ne s’arrête pas à la fin de l’hospitalisation. Souvent, il y a dans un premier temps une thérapie ambulatoire. Il est parfois nécessaire de passer par un centre de rééducation. Les progrès se font par petites étapes : ils sont rapides au début, ensuite plus lents. Mais une amélioration est possible jusqu’à environ un an après l’accident vasculaire cérébral.
Le rôle essentiel de la famille et des aidants
Ils apportent un soutien émotionnel et de la motivation, ils aident dans les activités de la vie quotidienne, ils administrent les médicaments et ils soutiennent les changements dans le mode de vie pour prévenir un nouvel AVC.
Leur implication permet au patient de rester actif et motivé pendant sa rééducation et elle peut améliorer sensiblement les résultats. En outre, les aidants font office de porte-parole auprès des prestataires de soins de santé et ils veillent aux intérêts du patient.
Personne n’est à l’abri d’un AVC mais le risque augmente avec l’âge. Et si vous ne pouvez pas changer votre âge, vous pouvez modifier votre mode de vie, et cela peut faire une grande différence. Si vous présentez un risque élevé, vous devrez parfois prendre des médicaments.
Si vous avez déjà été victime d’un AVC, le corps médical parle de « prévention secondaire » : prévenir un nouvel accident vasculaire cérébral.
L’importance d’un mode de vie sain
Presque toutes les directives médicales se rejoignent pour affirmer qu’un mode de vie sain est la clé pour réduire le risque d’AVC (et d’autres maladies cardiovasculaires). Voici les principaux piliers :
1. Ne pas fumer
Le tabagisme est l’un des principaux facteurs de risque. Plus vous fumez, plus le risque d’AVC est élevé. Dans une étude impliquant des personnes suivies pendant sept ans et demi en moyenne, les fumeurs victimes d’un AVC avaient 2,27 fois plus de risques de décéder que les patients n’ayant jamais fumé. En d’autres termes, le tabagisme augmente considérablement le risque de décès à la suite d’un accident vasculaire cérébral.
Bonne nouvelle : il est bénéfique d'arrêter de fumer à tout âge. Des études montrent que cinq ans après avoir fumé votre dernière cigarette, votre risque de développer une maladie cardiovasculaire est presque aussi faible que celui d'une personne qui n'a jamais fumé.
2. Bouger suffisamment
L’activité physique est un pur bienfait pour la santé. Selon des études, les personnes très actives ont 27 % de risques en moins d’être victimes d’un AVC que des personnes qui ne font pratiquement pas d’exercice physique. Même une activité physique modérée diminue déjà le risque de 20 %.
3. Limiter la consommation d’alcool
Un verre est autorisé mais il faut consommer l’alcool avec modération. Une consommation quotidienne augmente le risque d’hémorragie cérébrale. Pour les AVC ischémiques, le risque le plus faible correspond à un seul verre par jour. À partir de trois verres, le risque d’AVC ischémique et de décès augmente fortement, aussi bien chez les femmes que chez les hommes. Il est possible que l’effet hypertenseur de l’alcool joue un rôle important.
4. Surveiller son poids
Les personnes en surpoids (avec un IMC de 25 à 29,9) ont 22 % de risques en plus d’être victimes d’un AVC ischémique. En cas d’obésité (IMC supérieur à 30), le risque passe à 64 %. Essayez donc de maintenir un poids sain ou de perdre quelques kilos si vous êtes en surpoids. Même s’il n’y a pas de lien clairement établi entre le surpoids ou l’obésité et le risque d’hémorragie cérébrale.
5. Manger sain et équilibré
L’American Heart Association (AHA) recommande un régime méditerranéen pour diminuer le risque d’AVC. Pour en savoir plus, cliquez ici. Ou privilégiez simplement une alimentation saine.
Les médicaments pour réduire le risque d’AVC
Parfois, un mode de vie sain ne suffit pas. Les personnes présentant un risque (très) élevé d’AVC (ou de crise cardiaque) doivent souvent prendre des médicaments comme des hypotenseurs, des hypocholestérolémiants (des statines dans la majorité des cas) ou des anticoagulants.
Un risque élevé d’AVC dépend de différents facteurs. Votre médecin peut évaluer votre risque en pratiquant le test STROKE-2. Certaines personnes présentent un risque (très) élevé d’accident vasculaire cérébral, par exemple :
- Les patients qui ont déjà subi un AIT ou un AVC.
- Les patients qui présentent d’autres troubles cardiovasculaires dus à l’athérosclérose.
- Les personnes qui souffrent de diabète de type 2 depuis plus de dix ans.
- Les personnes qui souffrent de diabète de type 2 et dont la glycémie est mal contrôlée.
- Les personnes atteintes d’insuffisance rénale chronique.
- Les personnes souffrant d’hypertension artérielle significative.
- Les personnes qui souffrent d’hypercholestérolémie familiale.
Bon à savoir aussi
- Contraception et hormonothérapie: si vous avez été victime d’un accident ischémique transitoire (AIT) ou d’un accident vasculaire cérébral, les contraceptifs contenant des œstrogènes et les traitements hormonaux contenant des œstrogènes pour les symptômes de la ménopause sont déconseillés.
- Apnée du sommeil: le syndrome d’apnées obstructives du sommeil (SAOS) sévère multiplie par deux le risque d’AVC, en particulier chez les personnes jeunes et d’âge moyen. La ventilation en pression positive continue (PPC) peut réduire le risque d’AVC, en particulier chez les patients qui suivent scrupuleusement leur traitement.
Un AVC peut survenir subitement et constitue dans tous les cas une urgence médicale. Agir rapidement est crucial : appelez immédiatement le 112 et notez l’heure à laquelle les premiers symptômes sont apparus.
- Soyez attentif à toutes les manifestations: le visage de travers, l’impossibilité de lever un bras ou des troubles de l’élocution sont des signes avant-coureurs. Un mini AVC (IAT) est aussi un signe avant-coureur sérieux, même si les symptômes disparaissent rapidement.
- Le traitement dépend du type d’AVC: dans le cas d’un AVC ischémique, une thrombolyse ou une thrombectomie peut sauver la vie. Dans le cas d’un AVC hémorragique, le focus est mis sur la stabilisation et le contrôle des séquelles.
- La rééducation est essentielle: une thérapie commencée rapidement, intensive et ciblée aide le patient à récupérer ses fonctions et son autonomie. La famille et les aidants jouent un grand rôle.
- La prévention est importante: un mode de vie sain et une bonne gestion de la tension artérielle, du cholestérol et du diabète sont importants. Il est parfois nécessaire de prendre des médicaments comme des hypotenseurs, des statines ou des anticoagulants. Des visites régulières chez le médecin généraliste ou un spécialiste peuvent éviter la prise de médicaments.
Pour résumer : un accident vasculaire cérébral nécessite une intervention rapide, un traitement adapté et une rééducation ciblée, avec le soutien de la famille et du personnel soignant. Chaque minute compte et augmente les chances de guérison et de retrouver une vie aussi normale que possible.

