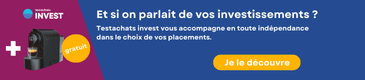Les droits des jeunes : ce que vous devez savoir avant 25 ans
À quel âge peut-on signer un contrat de travail, être entendu par un juge ou acheter une bière ? À partir de quand peut-on être responsable d’un accident ou d’une infraction ? De 0 à 25 ans, les droits et responsabilités évoluent considérablement. Voici un guide complet pour y voir clair.

Sur cette page
- De la naissance à la majorité : comment évoluent les droits d’un jeune ?
- La responsabilité pénale des jeunes : des mesures éducatives plutôt que répressives
- Être entendu par un juge : à partir de quel âge ?
- Les droits des jeunes évoluent avec l’âge : repères pratiques
- L’émancipation : être majeur avant l’heure
- Argent, contrats, et consommation : ce que la loi autorise
- Alcool, tabac, sexualité : que dit la loi ?
- Les jeunes et la justice : comment faire valoir ses droits ?
- En résumé : vos droits, âge par âge
- Droits des jeunes : où s’informer et obtenir de l’aide ?
De la naissance à la majorité : comment évoluent les droits d’un jeune ?
La capacité juridique : une compétence qui s'acquiert progressivement
Un enfant n’a pas la pleine capacité juridique dès la naissance. Jusqu’à sa majorité, il est en principe représenté par ses parents pour tout acte juridique. Cela ne signifie pas pour autant qu’il est complètement passif : la loi autorise certains actes dès le plus jeune âge, comme ouvrir un compte épargne ou effectuer des achats du quotidien.
Dès sa naissance, l’enfant a des droits fondamentaux :
- intégrité physique, morale,
- droit à l’image,
- vie privée, etc.
Mais pour exercer activement ces droits – par exemple signer un contrat – il faut la capacité juridique, qui s'acquiert généralement à 18 ans, sauf cas d’émancipation.
La capacité de discernement : un critère essentiel… jusqu'en 2025
Jusqu’au 31 décembre 2024, la responsabilité civile des mineurs reposait sur leur discernement, évalué par le juge au cas par cas. Mais depuis le 1er janvier 2025, un nouveau critère objectif est introduit dans le Code civil : l’âge.
- Moins de 12 ans : un enfant ne peut jamais être déclaré responsable civilement pour un dommage causé. Pour obtenir réparation d’un dommage causé par un mineur de moins de 12 ans, les victimes doivent faire appel à l’assurance en responsabilité civile familiale des parents de ce mineur.
- À partir de 12 ans : le jeune peut être tenu civilement responsable, mais le juge peut moduler l'indemnisation selon les circonstances (gravité, moyens financiers, etc.).
Ce changement vise à rendre les décisions plus prévisibles et équitables.
Attention, si le mineur ayant commis le dommage est couvert par un contrat d’assurance en responsabilité civile, le juge ne peut pas décider que le montant dû pour réparer le dommage soit inférieur à ce que couvre l’assurance compte de l'évolution psychologique des enfants.
La responsabilité pénale des jeunes : des mesures éducatives plutôt que répressives
Un principe : les mineurs sont pénalement irresponsables… jusqu'à 18 ans
Les enfants sont irresponsables pénalement et les parents ne sont pas pénalement responsables des bêtises de leurs enfants. Les parents ne sont dès lors jamais poursuivis pénalement en lieu et place de leurs enfants.
En Belgique, un mineur de moins de 18 ans ne peut pas être jugé comme un adulte. En cas de "faits qualifiés d'infraction", il est considéré comme un mineur en danger, devant bénéficier avant tout d’une approche éducative.
Le juge de la jeunesse peut imposer des mesures telles qu’un placement, des travaux d’intérêt général ou un accompagnement éducatif.
À partir de 16 ans, le mineur peut être renvoyé devant un tribunal pour adultes, dans des cas graves ou en cas de récidive.
Le rôle de l’avocat : une protection systématique
Tout jeune poursuivi bénéficie gratuitement d’un avocat, désigné d’office. Celui-ci le représente s’il a moins de 12 ans, et l’assiste au-delà de cet âge. Il est impossible pour un mineur de renoncer à ce droit.
Vers le haut de la pageÊtre entendu par un juge : à partir de quel âge ?
Une avancée majeure avec la loi d’avril 2024
Depuis avril 2024, tout enfant peut être entendu par un juge dans une procédure le concernant, même s’il a moins de 12 ans, sous certaines conditions.
- Moins de 12 ans : l’enfant peut être entendu, si le juge l'estime utile et motivé.
- À partir de 12 ans : le juge doit l’entendre, sauf refus exprès de l’enfant.
Ces auditions peuvent concerner la garde (en matière familiale), la scolarité, les successions, l’adoption, la filiation…

Les droits des jeunes évoluent avec l’âge : repères pratiques
À 12 ans
- Peut être tenu responsable civilement.
- Doit être entendu en justice s'il en fait la demande.
- Doit donner son accord pour être adopté ou reconnaître un lien de filiation.
À 15 ans
- Peut être émancipé par décision judiciaire.
- Peut percevoir directement son salaire (avec autorisation du juge si les parents s'y opposent).
À 16 ans
- Peut avoir des rapports sexuels avec des personnes proches en âge.
- Peut être renvoyé devant une juridiction pénale pour adultes.
- Peut rédiger un testament ou recevoir ses allocations familiales à une autre adresse.
À 18 ans
- Devient majeur juridiquement et pénalement.
- Peut signer un contrat de bail, voter, travailler sans restriction, être poursuivi comme un adulte.
Jusqu’à 25 ans
- Peut encore percevoir les allocations familiales, sous conditions (études ou stage d’insertion).
L’émancipation : être majeur avant l’heure
L'émancipation : qu’est-ce que c’est ?
L’émancipation permet à un jeune de 15 ans ou plus d’être assimilé à un majeur sur le plan juridique. Elle peut être obtenue :
- Par le mariage (très rare, autorisé par le tribunal),
- Par décision judiciaire, à la demande des parents, du tuteur ou du Procureur du Roi.
Un mineur émancipé peut signer un contrat de bail, percevoir ses revenus, agir en justice… mais il reste mineur aux yeux du droit pénal et soumis à l’obligation scolaire.
Vers le haut de la pageArgent, contrats, et consommation : ce que la loi autorise
Achats du quotidien, abonnements, gros achats : attention !
Un jeune peut acheter seul certains biens de la vie courante (pain, vêtements…), mais pas conclure de contrats engageants (crédit, location…). Les achats disproportionnés peuvent être annulés par le juge, sur demande des parents.
Exemple : un mineur de 13 ans qui achète une télévision haut de gamme pourrait voir cet achat annulé si on prouve qu’il a été lésé.
Job étudiant, travail rémunéré : à quelles conditions ?
- Moins de 15 ans : travail interdit (sauf exceptions encadrées, comme mannequinat, théâtre).
- À partir de 15 ans : peut travailler si plus soumis à l’obligation scolaire à temps plein.
- Les rémunérations sont protégées : versées sur un compte bloqué, accessible uniquement à sa majorité.
Alcool, tabac, sexualité : que dit la loi ?
Alcool et tabac : des limites claires
- Alcool : vente interdite aux moins de 16 ans (bière/vin) et aux moins de 18 ans (alcools forts).
- Tabac : interdiction totale de vente aux moins de 18 ans (y compris cigarettes électroniques).
Les vendeurs doivent vérifier l’âge, sous peine d’amendes allant jusqu’à 8000 €.

Sexualité et majorité sexuelle
- Âge du consentement : 16 ans.
- Exceptions : des relations sexuelles entre adolescents sont permises dès 14 ans, si l’écart d’âge est inférieur à 3 ans.
- Une relation entre un adulte et un mineur reste une infraction si cet écart dépasse 3 ans.
Les jeunes et la justice : comment faire valoir ses droits ?
Accès à un avocat et aide juridique
Tout jeune a droit à l’aide juridique gratuite (pro deo), même sans ses parents. Il peut consulter un avocat seul, notamment en cas de conflit familial ou s’il est en danger.
Représentation légale et tuteur ad hoc
Un mineur est en principe représenté par ses parents. Mais en cas de conflit ou d’inaction, un tuteur ad hoc peut être désigné pour défendre ses intérêts, y compris contre ses propres parents.
Vers le haut de la pageEn résumé : vos droits, âge par âge
Vers le haut de la pageDroits des jeunes : où s’informer et obtenir de l’aide ?
- Service Droit des Jeunes : sdj.be
- Infor Jeunes : inforjeunes.be
- AMO, MADO, CPAS, services d’aide à la jeunesse
- Bureaux d’aide juridique (BAJ) : consultation gratuite
Plus sur les droits des consommateurs
Vers le haut de la page