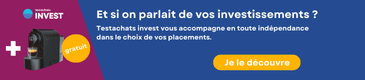Alcool et alimentation : tout ce que vous devriez savoir


Evidemment, l’alcool n’est pas idéal pour conserver sa ligne. Contrairement à la consommation de soda, on sous-estime d’ailleurs trop souvent la quantité de calories présentes dans un verre d’alcool. Même si, l’indication de la valeur nutritionnelle sur l’étiquette est obligatoire depuis fin 2014 pour la plupart des denrées alimentaires, les boissons alcoolisées échappent à cette obligation.
En février 2021, la Commission européenne a publié son plan européen de lutte contre le cancer dont l'un des engagements clés est de proposer une indication obligatoire de la liste des ingrédients et de la déclaration nutritionnelle sur les étiquettes des boissons alcoolisées avant la fin de 2022. Un engagement que nous soutenons car, à l’heure où les niveaux de surpoids et d'obésité sont élevés en Europe, les informations nutritionnelles apparaissent comme un outil crucial pour permettre aux consommateurs de faire des choix éclairés et plus sains au supermarché.
Toutefois, pour le moment, les boissons alcoolisées ne sont pas tenues de mentionner le nombre de calories et de sucres contenus par 100ml. Pourtant, ces données ne sont pas négligeables dans l’apport calorique puisque l’alcool contient sept calories par gramme. En comparaison, le gras apporte lui neuf calories par gramme. Et l’alcool pur n’est pas le seul élément à influencer la teneur en calories d’une boisson alcoolisée. Les ingrédients qui entrent dans le processus de production - comme le sucre, le blé, l'orge et le raisin - y contribuent également. Les boissons prémélangées, que l'on trouve facilement dans les supermarchés, peuvent également être extrêmement concentrées en calories.
Voici un aperçu par type de boisson du nombre moyen de kilocalories que vous ingérez pour une quantité standard et l’équivalent en sucres :
Au vu de la quantité de carrés de sucres présents dans un verre, rien d’étonnant à ce que les boissons alcoolisées soient situées au sommet de la pyramide alimentaire francophone. Elles font d’ailleurs partie de la catégorie des “non indispensables” au même titre que les produits gras, sucrés et/ou salés, viandes transformées et boissons sucrées, et doivent donc être consommées en petite quantités.
Il est clair que la consommation excessive d’alcool est préjudiciable à la santé. Selon l’OMS, dans le monde, trois millions de décès par an sont liés à son abus. En Belgique, elle est la quatrième cause de mortalité et de morbidité chez les personnes de plus de 15 ans. Parmi ses conséquences, nous pouvons par exemple citer l’apparition de cancers, des accidents vasculaires cérébraux, cirrhoses du foie mais également des décès à la suite d’accidents, des agressions ou encore des suicides.
Pourtant, l’alcool continue d’être consommé. L’idée selon laquelle une consommation modérée de vin ou de bière est saine, voire même nous protégerait de certaines maladies (Alzheimer, Parkinson, maladies cardiovasculaires, etc.) est d’ailleurs assez répandue.
Dans les faits, une consommation d’alcool régulière est dangereuse, et ce, même si elle ne s’élève qu’à un ou deux verres quotidiens, selon une analyse sur l’alcool et la santé réalisée sur la base des données du Global Burden or Disease, de 1990 à 2016 dans 195 pays et pour une population âgée de 15 à 95 ans.
En 2018, le Conseil Supérieur de la Santé a ainsi revu à la baisse les recommandations en matière d’alcool. Si l’idéal reste bien évidemment de limiter au maximum sa consommation d’alcool, le CSS préconise de ne pas en consommer avant l’âge de 18 ans, de ne pas boire plus de dix unités standards d’alcool par semaine, à répartir sur plusieurs jours, et de prévoir enfin plusieurs jours dans la semaine sans alcool.
Une unité standard d’alcool représente 10 g d’alcool ce qui correspond à un verre de 25 cl de bière à 5% ou un verre de vin de 10 cl à 12% ou un verre d’apéritif de 5 cl à 25% ou un verre d’alcool fort de 3,5 cl à 35%. Ainsi, la taille d’un verre standard est adaptée à la teneur en alcool dans chaque type de boisson alcoolisée.
Enfin, pour les femmes enceintes ou qui souhaitent le devenir ainsi que les femmes qui allaitent, il est recommandé de ne pas boire d'alcool.
Une fois ingéré, l’alcool est absorbé en majeur partie par notre corps à travers les muqueuses présentes dans l’estomac et l’intestin grêle. Il passe ensuite rapidement dans le sang, qui en allant vers le cœur, transporte l’éthanol et dans une moindre mesure, le méthanol vers le foie, où ils sont métabolisés en substances assimilables.
Concrètement, les enzymes du foie (enzyme déshydrogénase) s’occupent d’abord de transformer l’éthanol en acétaldéhyde (toxique pour notre organisme) puis une autre enzyme, l’acétaldéhyde déshydrogénase, va encore le transformer en acétate, cette fois inoffensif pour le corps. Peu présent dans les alcools de qualité, le méthanol, quant à lui, est un composé particulièrement nocif qui, en grande proportion, pourrait provoquer la cécité.
Dans la mesure où la vitesse d’absorption est supérieure à la vitesse de métabolisation, lorsque de grandes quantités d’alcool sont ingérées en peu de temps, le foie n’est pas en mesure de métaboliser tout l’éthanol au même rythme qu’il rentre dans la circulation sanguine. Ainsi une certaine quantité d’éthanol circulera dans l’organisme, endommageant les tissus.
Enfin, si la majeure partie de l’alcool (90%) est éliminée par le métabolisme, la partie restante (10%) se retrouve telle quelle dans nos urines, notre sueur et l’air expiré car l’alcool a été amené aux poumons par le sang. Dès lors, il est possible de détecter sa présence dans le sang au moyen d’alcootests.
Une fois passé dans le sang, l’alcool se répand dans tout l’organisme dont le cerveau, les poumons et le foie avec différentes conséquences :
- Diminution de la maîtrise de soi, de l’inhibition, de la capacité de concentration
- Affectation de la mémoire, troubles de la motricité et de coordination
- Augmentation de l’activité cardiaque
- Accélération de la respiration
- Irritation de la muqueuse gastrique. Lorsque qu’une petite quantité d’alcool est consommée, l’intestin sécrète de l’acide. Au fur et à mesure que l’alcoolémie augmente, la sécrétion de pepsine, une hormone digestive, est réduite, ce qui entraîne une irritation des parois de l’intestin et éventuellement de la diarrhée.
- Diminution du niveau de l’hormone antidiurétique. Les reins ne réabsorbent plus suffisamment d’eau des urines et le corps élimine plus d’eau qu’il n’en absorbe, ce qui provoque une déshydratation et oblige à prélever de l’eau sur d’autres organes comme le cerveau d’où le mal de crâne et la fatigue.
- Dilatation des vaisseaux sanguins avec comme conséquences des joues rouges, une perte de chaleur ainsi qu’une diminution de la température corporelle. Contrairement à ce que l’on peut penser, boire de l’alcool pour se réchauffer lorsqu’il fait très froid est donc dangereux.
Sur le long terme, le foie est l’organe qui souffre le plus d’une consommation excessive d’alcool. Cette dernière cause en effet des lésions hépatiques pouvant aboutir à une stéatose (foie gras), une hépatite, une cirrhose alcoolique ou encore un cancer du foie.
Une consommation importante d’alcool impacte également d’autres organes comme l’œsophage, le tube digestif et le pancréas. Sans compter l’augmentation du risque de développer différents cancers dont celui du sein chez la femme. Enfin, il cause également des dommages fonctionnels au niveau du système nerveux.
Comme pour d’autres choses, nous ne sommes pas tous égaux face à l’alcool et les effets d’une même quantité d’alcool varient d’une personne à l’autre. Plus l’on boit, plus l’alcool est métabolisé rapidement et plus notre tolérance à l’alcool augmente. De fait, si notre consommation d’alcool est “habituelle”, on “résistera” mieux que si l’on boit que très occasionnellement.
Mais les effets de l’alcool peuvent également varier d’un jour à l’autre pour un même individu, en fonction par exemple, de son état de fatigue, de la consommation pendant ou à distance d’un repas ou de la prise de médicaments.
D’autres facteurs influencent enfin le métabolisme, notamment la teneur en alcool. Les boissons fortement alcoolisées seront absorbées plus lentement car elles irritent les parois de l’estomac, ce qui a pour effet de retarder l’ouverture de la valvule pylorique et donc retarde le passage de l’alcool de l’estomac vers l’intestin grêle. Si vous prenez des shots dans le but de ressentir des effets plus rapides, vous pourriez être intoxiqué que tardivement contrairement à ce que vous espériez.
Les boissons gazeuses, comme le champagne par exemple, accélèrent, elles, la vidange gastrique et favorisent une absorption rapide. L’exercice physique et la chaleur accélèrent également l’absorption.
D’abord, ne consommez pas d’alcool le ventre vide. Les glucides, les graisses et les protéines présentes dans un repas protègent l’estomac et ralentissent l’absorption de l’alcool.
Pensez à alterner boissons alcoolisées et verres d’eau cela vous permettra de maintenir votre corps hydrate et vous aidera à éviter le sempiternel mal de crâne.
Espacez au maximum les boissons alcoolisées afin que votre corps puisse mieux métaboliser leurs composants.
Ne prenez pas de médicaments. Ces derniers potentialisent ou inhibent les effets de certains d’entre eux.
Bien sûr, ne conduisez pas.
Si vous vous posez des questions concernant la conduite en état d'ébriété, consultez notre dossier Alcool et assurance auto.
Le lendemain, mangez quelque chose, même un peu et buvez beaucoup d’eau.
Si vous avez besoin d’un antidouleur, ne prenez pas ceux qui contiennent de l’acide acétylsalicylique comme l’aspirine, car ils irritent l’estomac déjà bien endommagé. Dans ces circonstances, un analgésique à base de paracétamol est préférable.
Aujourd’hui, les boissons alcoolisées échappent à l’obligation d’indiquer les informations nutritionnelles, nous estimons donc que cette exemption actuelle accordée aux produits alcoolisés est inacceptable du point de vue du consommateur.
Les informations nutritionnelles devraient figurer aussi bien pour 100ml que par portion et une déclaration nutritionnelle complète, et pas seulement les calories/énergie, ainsi qu’une liste des ingrédients, doivent être reprises sur le contenant.
Bien que le secteur de l’alcool soit tenu d'informer les consommateurs si leur produit contient l'un des allergènes les plus courants, comme ils ne sont pas tenus de fournir des informations sur les ingrédients, les consommateurs allergiques à des substances moins courantes sont actuellement incapables de savoir, à partir de l'étiquette, si un produit alcoolisé peut contenir une telle substance. Il est important que ces informations soient instantanément disponibles pour les consommateurs sur l'étiquette.
Comme le préconise le Conseil Supérieur de la Santé, le nombre d’unités standards d’alcool contenu devrait également être présent sur le contenant.