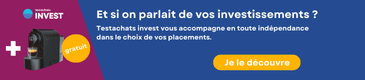Que savoir quand on achète de la viande de bœuf?


Nous vous expliquerons dans un premier temps quels sont les facteurs qui impactent le goût de la viande, ainsi que ceux qui exercent moins d’influence. Nous vous détaillerons également de quoi est composé le bœuf en vous indiquant les noms officiels des différentes pièces de viande. En effet, trop souvent, les vendeurs recourent à des dénominations culinaires ou des noms inventés.
Grâce à notre enquête, nous vous révélerons aussi où trouver la meilleure viande, et nous nous attarderons sur le cas de la viande "bio": son goût, sa qualité, son type d’élevage, etc.
Enfin, nous terminerons par aborder les questions de nutrition, de durabilité et de bien-être animal.
Plusieurs facteurs entrent en jeu tels que la texture de la viande, la teneur en graisses, le type de bovins, etc. Toutefois, il est difficile de déterminer l’impact et l'importance de chaque facteur individuel.
Facteurs ayant un impact sur le goût
Teneur en graisse
La teneur en graisse intramusculaire a une influence importante sur le goût. La quantité de graisse d’un bœuf augmente tout au long de sa vie, et encore davantage pendant la phase d’engraissement juste avant d’être abattu. Au début de la vie de l'animal, c’est d’abord et avant tout du tissu musculaire qui se développe. Ensuite, la graisse, elle aussi, commence à s’accumuler, d’abord de la graisse sous-cutanée (juste sous la peau) ainsi que de la graisse viscérale, et ensuite de la graisse intramusculaire qui vient se déposer entre les muscles (c'est celle qui donne du goût).
Plus l'animal est âgé, plus la graisse a le temps de s’accumuler. Les jeunes animaux ont donc moins de graisse, et souvent peu ou pas du tout de graisse intramusculaire. La phase d'engraissement ne peut pas y faire grand-chose. Les jeunes taureaux ne peuvent jamais obtenir, pendant la période d’engraissement, une quantité de graisse équivalente à celle d’un animal plus âgé, et pas non plus aux endroits souhaités (à savoir de manière intramusculaire).
Les femelles ont souvent une meilleure viande, car elles sont généralement abattues plus tard dans leur vie. En effet, elles vivent plus vieilles que les mâles parce qu’on les élève à deux fins: produire des veaux et ensuite produire de la viande.
Pièces de viande
Les différences vraiment perceptibles en termes de goût se situent toutefois surtout au niveau des pièces de viande. Les morceaux les plus recherchés sont en général le filet pur (pour sa tendresse), l’entrecôte, le contre-filet, la petite tête (rumsteak) et la tache noire (partie de la grosse cuisse) pour leur saveur.
Processus d’abattage
Le processus d’abattage a également une grande influence. En effet, un animal ne doit pas être stressé lors de son abattage, sinon cela peut nuire au goût et à la texture de la viande.
Maturation
Un bon morceau de bœuf doit également pouvoir mûrir pendant un certain temps, car la maturation rend la viande plus tendre. Pour cela, après l’abattage, on la pend à un "crochet" de 7 à 21 jours dépendant du morceau.
Facteurs ayant moins d’impact sur le goût
Races
Il faut savoir que la race n’a pas une influence très importante sur le goût. Il y a toutefois des variétés qui sont connues pour leur goût plus intense du fait d’une teneur élevée en graisse intramusculaire. On peut mentionner, à ce titre, le Wagyu et les variétés apparentées d’Asie du Sud-Est réputées pour être plus savoureuses que les variétés de nos régions.
Les races d’origine anglaise (comme l’Angus) ont également une teneur en matières grasses plus élevée et sont réputées pour leur goût.
Nourriture du bétail
En ce qui concerne la nourriture donnée au bétail, elle ne jouerait pas un rôle déterminant dans le goût, bien qu'elle ait son importance pendant l’engraissement afin d'obtenir des dépôts de graisse suffisants.
Manque de clarté
Concernant les étiquettes, on trouve trop souvent sur les emballages des noms culinaires ou des noms inventés qui ne veulent rien dire et qui ne sont pas liés à la partie du bovin dont ils proviennent. L'infographie ci-dessus indique les véritables dénominations du boeuf.
À titre d’exemple, nous avons trouvé lors de notre enquête sur le terrain (en 2020) des morceaux de viande étiquetés "chateaubriand" qui ne provenaient pas du filet pur comme l’on pourrait s’y attendre.
Nous avons également constaté la vente de plusieurs morceaux de viande sous des noms inventés tels que "steak maître d’hôtel", "steak minute" ou "steak du chef" qui n’indiquent en rien la provenance du morceau.
Difficile dans ce cas pour le consommateur de savoir à quel morceau de la vache il a affaire et si le prix qui lui est demandé est juste. Nous plaidons donc pour un cadre légal et un étiquetage plus clair obligatoire qui indiquerait le nom officiel ainsi que l’appellation culinaire du morceau de viande. On pourrait ainsi lire sur une étiquette "filet de bœuf, façon chateaubriand".
Notre réponse: chez le boucher.
On peut en général s’attendre à une viande plus savoureuse et plus juteuse dans les boucheries, car on trouve davantage de bovins femelles qui vivent plus longtemps. Comme décrit précédemment, leur chair est généralement plus juteuse et plus savoureuse.
En achetant votre viande chez le boucher, vous pouvez aussi vous assurer plus facilement de l'origine des produits en discutant avec lui, et choisir ainsi une viande plus locale et donc plus durable.
Au supermarché, le bœuf provient généralement de jeunes mâles, des animaux plus maigres choisis pour leur qualité plus uniforme et pour des raisons de rendement. La conséquence: une viande moins juteuse et moins savoureuse.
Mais attention, dans les deux cas, l’offre de viande sera toujours variable. En effet, un même morceau de viande provenant d'une même race pourra être de qualité très différente selon le poids, l’âge, l’engraissement de la bête et le processus d'abattage.
- À la suite d’analyses en laboratoire et de dégustations réalisées par un panel d’experts, nous avons conclu que la viande bio n’était ni plus saine ni plus goûteuse.
- D’un point de vue nutritionnel, la viande bio est légèrement plus grasse que la non "bio". Cela s’explique notamment, car les éleveurs bio recourent à des races de bœuf plus grasses que la race classique du Blanc bleu belge.
- Concernant les prix, notre enquête (en 2020) a révélé que la viande la plus chère était celle des supermarchés bio, suivie de très près par la viande du boucher bio (moins de 1€ de différence par kilo). Ensuite vient la viande du boucher conventionnel, 30% moins chère que celle du boucher bio. Et enfin, la viande des supermarchés conventionnels, en moyenne 70% moins chère que celle des supermarchés bio.
- L’agriculture biologique ne recourt à aucun engrais artificiels ni pesticides synthétiques pour cultiver la nourriture du bétail.
- L’élevage biologique se distingue par son attention au bien-être animal. Les animaux sont autorisés à paître à l’extérieur et disposent d’un espace suffisant pour se promener, se coucher et se nourrir. À la naissance, les veaux restent auprès de leur mère et sont nourris au lait maternel. Ceci n'est qu'un aperçu des règles que les éleveurs des filières bio doivent respecter. Cliquez ici pour en savoir plus.
La viande de bœuf crue est un produit relativement maigre. C’est sa préparation qui va faire la différence au niveau nutritionnel. Et on le sait, de nombreuses recettes à base de bœuf sont riches en sauces et en graisse.
On l’a dit, le bœuf "bio" a tendance à être légèrement plus gras, et donc un peu plus riche en acides gras saturés, déconseillés pour la santé. Cela s'explique par le fait que les vaches bio sont des races plus grasses que le Blanc bleu belge et qu'elles sont en général un peu plus âgées à l’abattage. En revanche, elles offrent un apport en acides gras mono-insaturés plus intéressant et leur rapport oméga-6/oméga-3 est légèrement plus favorable que le non bio.
Quoi qu’il en soit, le Conseil Supérieur de la Santé (CSS) recommande de limiter sa consommation de viande rouge à un maximum de 300 grammes par semaine.
L'Organisation mondiale de la santé (OMS) a conclu en 2015 qu'il existait un lien entre la consommation de viande rouge et un risque accru de cancer, en particulier du cancer du côlon. Il existe également des preuves solides d'une augmentation du risque de cancer du poumon dû à une forte consommation de viande rouge. Enfin, une consommation élevée de viande rouge serait également associée à un risque plus élevé d'accident vasculaire cérébral et de diabète de type 2.
Pour obtenir des pistes sur les façons de manger moins de viande, consulter notre dossier.
Opter pour des produits "plus durables" qui tendent à respecter la qualité de l’environnement, et en même temps diminuer sa consommation de viande deviennent des préoccupations centrales du consommateur. En effet, on le sait, l’élevage intensif de viande a un impact important sur l’environnement. Il est gourmand en eau, en terres et en énergie.
Les bovins ont également d’importants besoins en nourriture: pour chaque kilo de viande, 2 à 10 kg d'aliments sont nécessaires. La production d'aliments pour le bétail nécessite, elle aussi, d’importantes ressources naturelles et énergétiques.
Outre la production, le transport, la transformation, le stockage et le conditionnement de la viande influencent également le climat.
Enfin, de toutes les viandes, la production de bœuf est la plus polluante.
Pistes de solutions
La population belge en est de plus en plus consciente de ce problème et est en train de diminuer sa consommation de viande rouge. Celle-ci est passée de 19,6kg par habitant en 2014, à 16,4kg par habitant en 2019. Consommer moins de viande est un des gestes les plus impactant afin de prévenir le réchauffement climatique.
Toujours dans une perspective de manger plus durable, le développement des circuits courts et la consommation de produits locaux sont également essentiels. En effet, le transport est l'un des aspects les plus polluants de la chaîne du producteur au consommateur. La Belgique étant un petit pays, la chaîne y est plus courte que dans d'autres pays. Néanmoins, il est important de continuer à opter pour des ingrédients les plus locaux possible.
Les initiatives par lesquelles les consommateurs achètent de la viande directement à l'agriculteur gagnent d’ailleurs en popularité.
La viande biologique est-elle plus durable?
L’agriculture biologique n'utilise pas d'engrais artificiels ni de pesticides synthétiques : c'est mieux pour l'environnement. Elle n'exige aucune consommation d'énergie pour, par exemple, chauffer des serres. Cependant, l'agriculture et l'élevage biologiques nécessitent généralement plus de terres, qui ne sont alors plus disponibles pour la nature ou pour des produits ayant moins d'impact sur l'environnement.
Le bio n'est donc pas forcément plus durable. Cela dépend plutôt de l'agriculteur ou du producteur.
Consultez notre dossier afin de consommer de manière plus durable.
Des labels garantissant que le bien-être des animaux a été respecté lors de l’élevage des bêtes existent:
- Le label néerlandais "Beter Leven" (ndlr. "meilleure vie") garantit un meilleur respect du bien-être animal. Plus le nombre de critères respectés en la matière est élevé, plus le produit a d’étoiles (avec une note maximale de trois).
- Carrefour a également développé un label "Filière Qualité Carrefour" garantissant une viande 100% belge, issue d’élevages respectueux des animaux et de partenariats durables avec les producteurs.
- Le label "bio", lui aussi, garantit des règles strictes en matière d’élevage. Les éleveurs biologiques optent pour une approche respectueuse des animaux où le bien-être des vaches est primordial.
Pour en savoir plus sur les labels existants, consultez notre dossier.