Les maladies vectorielles

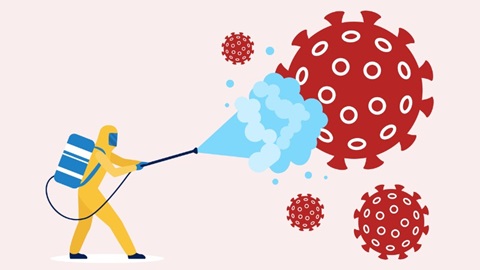
L'expression « maladie vectorielle » - on dit aussi « maladie à transmission vectorielle » - risque bien de faire partie de notre vocabulaire courant dans les années à venir. Au même titre que les mots « pandémie » et « confinement », que nous avons dû intégrer au quotidien depuis mars 2020 avec l'avènement du coronavirus sous nos latitudes. Mieux vaut donc s'y préparer pour comprendre de quoi on parle. Ce dossier vous y aidera.
1 million de morts par an
Qu'entend-on par « maladie vectorielle » ? Il s'agit de maladies humaines provoquées par des parasites, des virus ou des bactéries transmis par des « vecteurs ». Responsables de près d'une maladie infectieuse sur cinq à travers le monde, elles causent actuellement plus d’un million de décès chaque année. Un chiffre en augmentation constante, notamment à cause du réchauffement climatique.
Le paludisme (ou malaria), dont le vecteur est un moustique, est sans doute l'une des maladies vectorielles les plus connues du public, mais il en existe bien d'autres. Dont certaines sont déjà aux portes de l'Europe...
Les maladies à transmission vectorielle sont causées par des parasites, des virus ou des bactéries transmis par des vecteurs. Qui sont ces « vecteurs » ? Ce sont des organismes vivants capables de transmettre des maladies infectieuses d’un hôte à un autre. Beaucoup de maladies vectorielles sont des zoonoses, c’est-à-dire des maladies qui peuvent se transmettre directement ou indirectement entre les animaux (sauvages ou domestiques) et les humains.
La faute aux insectes hématophages
Les vecteurs sont majoritairement des insectes et acariens (tiques, moustiques, etc.) qui, lors d’un repas de sang (insectes « hématophages »), ingèrent des micro-organismes pathogènes présents dans un hôte infecté (homme ou animal). Ils les réinjectent ensuite dans un nouvel hôte après reproduction de l'agent pathogène. Souvent, lorsque l'insecte (ou autre vecteur) devient infectieux, il est capable de transmettre l'agent pathogène pour le reste de son cycle de vie, donc lors de chaque repas de sang.

Une tique, responsable de plusieurs maladies, dont celle de Lyme.
Quels sont les symptômes de toutes ces maladies ? Chacune a ses propres manifestations, notamment en fonction de son agent pathogène (virus, parasite ou une bactérie), allant d'éruptions cutanées, maux de tête et douleurs articulaires en passant par des pseudo-grippes ou des troubles neurologiques, et jusqu'à des fièvres hémorragiques mortelles.
Les maladies vectorielles touchent surtout des zones tropicales et subtropicales, et donc très souvent des populations déjà précarisées. Leur répartition dépend également de facteurs démographiques, environnementaux et sociaux. Beaucoup sont toutefois considérées comme des maladies infectieuses émergentes dans l’Union européenne, c’est-à-dire des maladies qui soit apparaissent dans une population pour la première fois, soit peuvent avoir existé auparavant mais dont l’incidence ou la diffusion s’accroît rapidement. Certains vecteurs sont capables de se déplacer sur des distances importantes, et d'ainsi conquérir de nouveaux territoires, via les oiseaux migrateurs et les déplacements animaliers, le vent, de nouvelles pratiques agricoles, le commerce mondial, les voyages internationaux...
Les vecteurs cartographiés
L’Autorité européenne de sécurité des aliments (EFSA) a imaginé des cartes digitales et interactives qui fournissent toutes les infos utiles sur 36 maladies vectorielles. On y découvre notamment les risques d'introduction en Europe, ainsi que les mesures de prévention et de lutte.
Par ailleurs, le projet VectorNet, une initiative conjointe de l'EFSA et de l'ECDC (Centre européen de prévention et de contrôle des maladies), collecte des données sur la présence et la distribution des vecteurs - et des agents pathogènes présents sur ces vecteurs - en Europe et dans le bassin méditerranéen. La base de données fournit des informations sur la répartition de plusieurs espèces de moustiques, tiques, phlébotomes et moucherons piqueurs qui peuvent servir de 'taxi' à des agents pathogènes à risque d'affecter la santé humaine et/ou animale.
Les maladies vectorielles sont nombreuses. Elles diffèrent par leur vecteur (un moustique, une tique, etc.), leurs agents pathogènes (des virus, des bactéries, des parasites), mais aussi par leurs modes de transmission. Il s’agit le plus souvent de piqûres (malaria, chikungunya, maladie du sommeil, de Lyme), mais la transmission peut aussi se faire par déjection de l'insecte (maladie de Chagas, rickettsioses) ou par régurgitation (peste).
Voici les plus courantes:
|
Vecteur |
Maladie |
Agent pathogène |
|
Moustique |
Paludisme |
Parasite |
|
(anopheles, aedes, culex) |
Chikungunya |
Virus |
|
|
Dengue |
Virus |
|
|
Fièvre de la vallée du Rift |
Virus |
|
|
Fièvre jaune |
Virus |
|
|
Zika |
Virus |
|
|
Encéphalite japonaise |
Virus |
|
|
Fièvre du Nil occidental |
Virus |
|
|
Filariose |
Parasite |
|
|
|
|
|
Mouche noire |
Onchocercose |
Parasite |
|
|
|
|
|
Puce |
Peste (via le rat) |
Bactérie |
|
|
Typhus |
Bactérie |
|
|
|
|
|
Escargot d’eau |
Schistosomiase/bilharziose |
Parasite |
|
|
|
|
|
Phlébotome (petit insecte ailé) |
Leishmaniose |
Parasite |
|
|
|
|
|
Tique |
Fièvre hémorragique Crimée-Congo |
Virus |
|
|
Bactérie |
|
|
|
Borréliose |
Bactérie |
|
|
Encéphalite |
Virus |
|
|
Tularémie |
Bactérie |
|
|
|
|
|
Réduve (un genre de punaise) |
Maladie de Chagas (trypanosomiase) |
Parasite |
|
|
|
|
|
Mouche tsé-tsé |
Maladie du sommeil (trypanosomiase) |
Parasite |
Les températures plus élevées sous l'effet du réchauffement climatique, associées à des pluies plus fréquentes et/ou extrêmes, favorisent les conditions de propagation des maladies à transmission vectorielle.
Les changements climatiques agissent à différents niveaux. Ils modifient par exemple les aires de répartition des insectes, les poussant notamment à remonter vers le Nord (= chez nous). Ils bouleversent aussi leur cycle de vie et la dynamique de transmission.
Les différents vecteurs (moustiques, tiques, puces et autres arthropodes) profitent par ailleurs d’autres opportunités, comme l’épuisement de la biodiversité et la mondialisation (commerce, déplacements humains). La vitesse à laquelle s'est propagé le coronavirus au début de l'année 2020 illustre parfaitement ce phénomène d'expansion rapide.
De plus en plus de cas en Europe
Mais les « vecteurs » de maladies qui nous menacent le plus, en tant qu'Européens, ne sont ni les chauves-souris ni les pangolins. D'autres épidémies tout aussi sinistres que la Covid-19 frappent à nos portes, dont certaines sont déjà bien là même si elles ont été un peu éclipsées par le coronavirus. Ainsi la dengue, une maladie naguère considérée comme exotique et donc lointaine, a fait 12 malades en France en 2020. La fièvre du Nil occidental a fait 336 cas en Europe la même année, dont 38 mortels. Le Chikungunya avait frappé 270 fois en Italie en 2017 et, selon l'Institut Pasteur, en France, 64 départements s'attendent à l'émergence de cette maladie. Un cas de Zika a été identifié à Hyères, dans le sud de la France (Var) en octobre 2019.
La carte de la malaria est également appelée à s'agrandir, avec de futurs possibles foyers du côté européen du bassin méditerranéen. Trop froid chez nous, pensez-vous ? Le nombre de mois propices à la transmission du paludisme a grimpé de 39 % dans des zones montagneuses de pays pauvres qui étaient pourtant épargnées, par rapport aux plaines, jusqu'il y a peu. Enfin, n'oublions pas la maladie de Lyme, que bien peu d'entre nous connaissaient à l'aube de ce troisième millénaire et qui nous est aujourd'hui devenue familière en Belgique.
« Le potentiel d'apparition de la dengue, du Chikungunya et du Zika augmente le plus rapidement dans les pays dont l'indice de développement humain est très élevé, notamment les pays européens », soulignaient les experts de The Lancet Countdown, en préambule de la COP26 à Glasgow. Ce rassemblement international d'experts, notamment universitaires et issus d'agences des Nations unies, placé sous l'égide de la prestigieuse revue scientifique The Lancet, surveille, de façon indépendante, les conséquences sanitaires du changement climatique. « L'évolution des conditions environnementales favorise la transmission de nombreux agents pathogènes transmis par l'eau, l'air, les aliments et les vecteurs. Bien que le développement socio-économique, les interventions de santé publique et les progrès de la médecine aient permis de réduire la charge mondiale de la transmission des maladies infectieuses, le changement climatique pourrait compromettre les efforts d'éradication », notent les experts dans leur rapport 2021.


