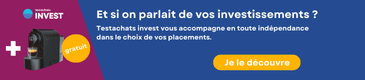Migration de substances à risque des emballages et récipients vers les aliments


Concrètement, cela veut dire quoi?
Par « migration », on entend le passage de composants chimiques provenant d’emballages ou de récipients aux denrées alimentaires.
Comment une migration de substances vers les aliments est-elle possible?
Ce passage peut se faire par contact direct (soupe en boîte, par exemple) ou indirectement, par évaporation dans l’air comme dans le cas des chips qui touchent à peine l’emballage.
L’éventail de matériaux dont des particules peuvent migrer dans les aliments est très large : plastique, colle, papier et carton, couches de vernis, aluminium, etc. La migration est donc une problématique très vaste.
Quels sont les effets possibles de ces migrations pour la santé?
Des risques d’intoxication aiguë ne sont pas à craindre. Mais l’absence de symptômes ou le fait qu’ils passent inaperçus n’excluent pas une intoxication chronique produisant risques et éventuels effets à long terme, comme la possibilité de développer un cancer ou de voir la fertilité baisser.
Comment éviter la migration vers les aliments?
Quels facteurs influencent une migration potentielle de substances?
Type d’aliment, température, durée de présence dans le contenant et composition de ce dernier exercent une influence sur l’éventuelle migration de substances vers les aliments. En savoir plus sur les conditions dans lesquelles le risque de migration augmente.
Nos 12 conseils pour éviter la migration de substances vers les aliments
On ne peut totalement l’empêcher, mais on peut minimiser cette migration de substances. En privilégiant des matériaux inertes, en ne réutilisant pas les emballages à usage unique,… Voyez ici nos autres conseils.
Réglementation et contrôles concernant ces migrations
Réglementation et contrôles des autorités sont-ils efficaces?
Il y a un fossé entre ce que la législation promet et la réalité. Découvrez pourquoi l’innocuité de la grande majorité des substances qui migrent n’a pas été testée.
Testachats agit au niveau européen
Nous réclamons depuis longtemps une meilleure information des consommateurs en vue d’éliminer les pratiques à risque ainsi qu’un renforcement des réglementations à l’égard de l’industrie pour garantir la sécurité de ce qu’elle produit. Voyez aussi les produits mis en cause lors de nos analyses.
Une combinaison de facteurs influe sur l’éventuelle migration de substances: le type d’aliments (gras ou acide, liquide ou solide), leur température (chaud ou froid), la durée de leur présence dans le contenant, et bien sûr la composition de ce dernier (sorte de plastique, métal, verre, carton avec ou sans encre, céramique, bois, etc).
La migration augmente dans quatre situations:
- en cas de plus grande surface de contact entre l’aliment et l’emballage;
- en cas de chauffage de l’aliment dans son emballage;
- lorsqu'il s'agit de produits gras;
- en cas de conservation longue du produit (contact de longue durée).
Globalement, la migration est faible dans les aliments crus ou congelés, mais importante dans les aliments transformés comme les sauces grasses et les produits pasteurisés ou stérilisés dans l’emballage.
Les huiles ou graisses à la surface des aliments augmentent le risque de migration, surtout pour les plastiques. Les aliments acides peuvent attaquer certains métaux comme l’aluminium, en particulier s’il ne bénéficie pas d’une couche de protection.
En ce qui concerne les films alimentaires, il est important de distinguer le polyéthylène du PVC plastifié. Ce dernier "colle" un peu mieux et est donc plus facile à utiliser, mais il peut libérer de grosses doses de plastifiants dans les aliments gras comme le fromage ou la viande. La plupart des films vendus sont en polyéthylène; la composition est d’ailleurs mentionnée sur l’emballage.
Notez que le four à micro-ondes n’augmente pas la migration par rapport aux autres modes de réchauffage.
On ne peut pas éviter totalement la migration, mais on peut essayer de la minimiser et espérer ainsi exclure les particules dangereuses.
1. Privilégiez les matériaux inertes comme le verre (résistant à la chaleur), l'acier inoxydable pour chauffer les aliments et stocker des aliments chauds, acides, salés ou gras. La céramique convient également pour autant qu’elle soit prévue pour le contact alimentaire, pas seulement pour la déco. Certains éléments décoratifs peuvent, en effet, contenir du plomb et du cadmium susceptibles d’être libérés au contact des aliments.
2. A défaut de matériaux inertes, suivez les recommandations des fabricants indiquées sur l'emballage des aliments. Le réchauffage extrême augmente le risque de migration des substances.
3. Il existe de nombreux plastiques différents : veillez à ce que l’utilisation (température - durée) que vous en faites est adaptée à sa composition. Les plastiques en contact avec les aliments sont soumis à la réglementation harmonisée la plus complète de l'UE. Retenez cependant qu’en présence d’aliments chauds ou chauffés , le plastique présente un risque de migration plus important. Prudence, donc.
4. Pour les emballages en aluminium, il faudrait pouvoir distinguer ceux qui bénéficient d’une couche de protection et les autres. Dans le doute et par précaution, n’utilisez pas de papier aluminium pour les aliments chauds, salés et acides, les fruits et les légumes.
5. Ne réutilisez pas les emballages alimentaires à usage unique à des fins pour lesquelles ils n'ont pas été conçus et testés. Evitez, en particulier, de réutiliser les pots, sacs ou bouteilles en plastique lorsqu'ils sont vides. N’y stockez pas boissons et aliments chauds et ne les mettez jamais au micro-ondes.
6. Choisissez les récipients pour aliments sur lesquels figure le symbole d’un verre et une fourchette. Ce symbole n’est pas obligatoire, mais sa présence aide à distinguer les récipients à usage alimentaire d’autres plats à usage décoratif.

7. N’utilisez pas quotidiennement des moules de cuisson en silicone. Ne les achetez pas dans les magasins en ligne bon marché. Vérifiez la température maximale sur le mode d'emploi. Il n'existe pas de règles européennes spécifiques pour garantir la sûreté de ces produits.
8. Attention aux récipients en carton, comme les gobelets à café par exemple. Si la législation générale stipule que l'utilisation des matériaux en contact avec les aliments doit être sûre, il n'existe pas de normes spécifiques, comme dans le cas des plastiques, stipulant la quantité maximale de substances pouvant migrer vers les aliments. Or, plusieurs études font état de la présence de substances chimiques indésirables provenant d'encres d'imprimerie, d'amines aromatiques, PFAS et d'huiles minérales.
9. La migration des substances est normalement plus élevée lors des premières utilisations.
Lavez soigneusement les ustensiles et récipients neufs avant leur première utilisation, même si cela ne résout pas tout (l’eau n’élimine que les substances solubles).
L’âge de vos récipients n’est donc pas un élément de risque en tant que tel.
C’est même l’inverse. L’usage répété des récipients réduit la migration, car les matériaux se débarrassent progressivement de leurs particules migrantes et deviennent donc "plus propres" au fil du temps.
En revanche, l’usure peut majorer les risques de migration. Soyez attentif aux rayures (profondes), à l'adhésivité, aux changement de texture. Par précaution, jetez donc vos récipients plastique lorsqu'ils présentent d’évidentes marques d’usure.
10. Evitez d'utiliser les canettes et les boîtes alimentaires qui sentent ou goûtent fortement le plastique ou le métal. Aussi bien l'odeur que le goût peuvent être des signes que le matériau a cessé d'être stable et est donc susceptible de libérer des produits chimiques dans les aliments.
11. Attention également aux ustensiles de cuisine: ne laissez pas d'ustensiles de cuisine en plastique (en mélamine) chauffer, et encore moins bouillir, dans la casserole.
12. Ne faites pas chauffer les poêles en teflon à vide, sûrement pas à puissance maximum.
La législation exige que les emballages ne constituent pas de risque pour la santé humaine. Idéalement, les emballages alimentaires devraient donc être fabriqués exclusivement à base de matériaux dont l’innocuité est prouvée, en ce compris les impuretés et produits de réaction formés pendant le processus de production.
Lorsqu’un fabricant souhaite utiliser de nouveaux matériaux d’emballage, ceux-ci devraient être approuvés au préalable par un organe de contrôle comme l’Agence européenne de sécurité alimentaire (EFSA). Mais nous en sommes loin dans la réalité. Le hic, c’est que personne n’a contrôlé l’innocuité de la grande majorité des substances qui migrent.
Par exemple, les composants individuels utilisés pour produire du plastique sont contrôlés, mais beaucoup d’autres substances pas. De plus, la plupart des substances migrantes sont formées par des réactions chimiques qui n’ont pas encore été contrôlées ni même identifiées. Il y a un fossé entre ce que la législation promet et la réalité.
Les autorités européennes et nationales sont conscientes de cette situation, mais n’ont pas les moyens d’y remédier. Et le fait qu’une grande partie de l’industrie est réticente à collaborer n’aide pas... Les entreprises veulent en effet s’autoréguler et s’autocontrôler, alors que l’expérience à montrer l’inefficacité de cette approche.
Quels contrôles des substances à risque?
Actuellement, quelque 1.500 substances pouvant migrer dans les aliments ont été analysées et approuvées par les experts de l’Union européenne ou nationaux. Pour toutes les autres substances susceptibles de migrer, c’est toujours l’incertitude qui règne.
On estime que 50.000 à 100.000 substances peuvent migrer dans les aliments en quantités potentiellement dangereuses. La grande majorité n’est pas si toxique que cela, mais il est probable qu’un certain nombre d’entre elles comportent des risques pour la santé. Même si on prend une estimation prudente de 0,1% des substances, cela fait toujours entre 50 et 100 substances nuisibles à la santé.
A noter qu‘ une partie des évaluations déjà effectuées, en particulier celles des matériaux utilisés, sont déjà obsolètes et devraient être revues, mais les budgets nécessaires ne sont pas disponibles.
Beaucoup dépend dès lors du bon vouloir de l’industrie, parce que les autorités ont peu de moyens pour assurer des contrôles approfondis. Il est grand temps que l’industrie garantisse l’innocuité de ce qu’elle produit. Elle dépense des sommes folles pour l’aspect marketing des emballages alimentaires, mais pratiquement rien pour leur sécurité.
En collaboration avec le Bureau européen des unions de consommateurs (BEUC), nous exigeons que vous receviez des informations plus claires sur les contenants alimentaires, leurs utilisations prévues et leur éventuelle réutilisation à des fins alimentaires.
Nous sommes également demandeurs de règles européennes obligeant les producteurs et les détaillants à s'assurer que leurs matériaux d'emballage sont sûrs en toutes circonstances. Cela signifie une interdiction par défaut de tous les substances chimiques extrêmement préoccupantes ainsi qu’une révision et extension des limites légales pour protéger les consommateurs de la libération de contaminants des emballages et ustensiles de cuisine vers les aliments.
Produits mis en cause lors de nos tests
Bisphénol dans les conserves, canettes et gourdes pour enfants
En 2012, à titre de précaution, l’Europe a banni l’utilisation de BPA, un perturbateur endocrinien, dans les biberons. Chez nous, la substance est aussi interdite dans les emballages d’aliments pour enfants jusqu’à 3 ans. Conjointement avec d'autres organisations européennes de consommateurs, nous avons testé en 2023 la présence de bisphénol dans 179 produits répartis en sept catégories : 58 pièces textiles (collants, couvertures et bavoirs pour bébés), 11 paires de chaussures en cuir, 16 paires de lunettes de soleil pour enfants, 20 anneaux de dentition, 22 canettes de boissons gazeuses, 35 canettes alimentaires, 16 gourdes ou gobelets.
Moules en silicone
Fin 2014, nous avons découvert, dans tous les moules testés, des composants chimiques qui passent dans les aliments. En 2022, un test conjoint avec plusieurs autres organisations européennes de consommateurs a révélé que le problème persistait. L'organisation européenne des consommateurs BEUC demande donc à l'UE de revoir sa législation sur les emballages alimentaires afin de mieux protéger les consommateurs.
Gobelets, pailles et autres articles de table jetables en papier et en fibres végétales
Un test réalisé par des organisations de consommateurs dans quatre pays européens en 2021 a révélé la présence de substances chimiques préoccupantes (PFAS, chloropropanol et pesticides) dans la vaisselle jetable populaire fabriquée à partir d'alternatives non plastiques, telles que les bols en fibres végétales, les pailles en papier ou les assiettes en feuilles de palmier. Le BEUC et ses organisations membres demandent instamment à l'UE de veiller à ce que les alternatives au plastique à usage unique soient sûres et n'induisent pas les consommateurs en erreur.
Produits en bamboo et melamine
En 2020, notre organisation sœur Altroconsumo a publié un test de 14 produits en "bambou" qui a révélé des problèmes de rejet de substances nocives, la mélamine et le formaldéhyde, qui peuvent être libérés à des températures dépassant 70°C, lors du réchauffement micro-ondes, par exemple. En 2021, des mesures ont été prises par l'Union Européenne.
Emballages de fast-food
En 2017, Testachats et 4 autres organisations de consommateurs en Europe effectuent une analyse d’emballages de fast-food et y détectent des composés chimiques fluorés (PFOS et PFAS). Ils ne constituent pas un risque direct pour la santé, mais bien pour l’environnement.
Aliments secs
En 2017, nous avons analysé 40 aliments secs dont notamment du riz, des pâtes, du chocolat et des céréales. Nous avons trouvé des MOSH dans la plupart d’entre eux, et parfois aussi des MOAH, des huiles minérales qui peuvent se révéler nocives pour la santé.
Huile d’olive avec phtalates
Lors du processus de production, des phtalates peuvent migrer dans l’huile d’olive. En 2007, nos analyses en labo n’ont cependant détecté que des teneurs infimes.