Pourquoi les médicaments orphelins sont-ils si chers?

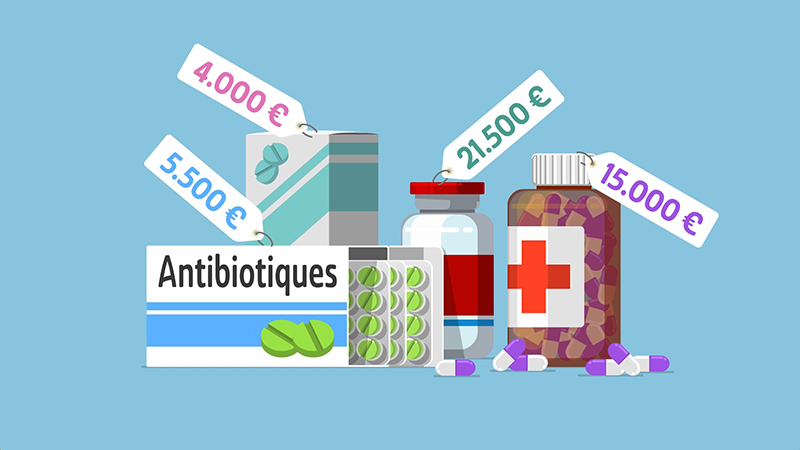
Concernant les médicaments orphelins, les contribuables paient également à plusieurs reprises. Quand, dans les années nonante, l’Europe a constaté qu’il manquait sur le marché des médicaments contre les maladies rares, elle a décidé de stimuler l’industrie pharmaceutique à investir dans des médicaments pour lesquels le groupe-cible est plus restreint et qui devraient donc procurer moins de bénéfices.
Cela a fonctionné, mais avec parfois des effets pervers. Certains de ce qu’on appelle les médicaments orphelins, développés notamment avec le soutien de l’argent public, rapportent par exemple un chiffre d’affaire annuel de plus d’un milliard d’euros.
Rectifier le déséquilibre
On compte dans le monde plus de 6 000 maladies orphelines, c’est-à-dire des affections graves touchant maximum 5 personnes sur 10 000. Comme les firmes pharmaceutiques préfèrent développer des nouveaux médicaments avec des débouchés plus importants et de plus gros bénéfices potentiels, elles ont longtemps ignoré ces maladies, censées être moins rentables.
C’est pour compenser ce déséquilibre que l’Europe a créé en 2000 le statut de médicament orphelin. Ses avantages? Réduction du coût d’enregistrement du médicament auprès de l’Agence européenne des médicaments (EMA), mesures pour stimuler la recherche, et une exclusivité commerciale de dix ans.
Ces nouveaux stimulants ont effectivement fait leur effet : ils ont entraîné le développement d’un plus grand nombre de médicaments contre les maladies rares. Entre 2001 et fin 2019, l’EMA a enregistré 169 médicaments orphelins.
Succès chèrement acquis
Ces stimulants nous ont coûté un paquet d’argent, alors que les prix de ces médicaments sont élevés. Les firmes justifient les hauts tarifs en assurant ne pouvoir récupérer les importants coûts de recherche et de développement des médicaments orphelins pour un petit groupe-cible qu’en pratiquant des prix assez élevés.
Mais les labos refusent toute transparence sur leurs coûts. Selon une analyse récente, les études cliniques pour les médicaments orphelins sont 30 % moins chères que pour les médicaments destinés aux affections courantes, car beaucoup moins de personnes participent aux essais.
Son exclusivité sur le marché, ainsi que les brevets, maintiennent en outre le monopole dont jouit un médicament (tout comme son prix élevé). Lorsque le statut d’orphelin est accordé à un médicament, ses concurrents ne peuvent mettre sur le marché aucun produit similaire et équivalent pour la même indication, autrement dit le profil auquel le traitement est destiné, pendant dix ans.
Une telle exclusivité peut habilement être mise en œuvre. Entre autres lorsque des brevets de molécules connues plus anciennes ont expiré, un phénomène relativement courant. Sans compter que leur protection est franchement plus étendue que celle d’un brevet ordinaire.
Enfin, pour chaque nouvelle maladie orpheline pour laquelle un même médicament s'enregistre, ce médicament peut à nouveau obtenir dix années d’exclusivité commerciale, assurant ainsi un monopole plus pérenne qu’avec un brevet. Quoi de mieux pour maintenir les prix au sommet ?
Revlimid : le médicament orphelin qui vaut des milliards
En 2018, le médicament Revlimid de la firme Celgene, initialement développé pour un type particulier de cancer du sang, a obtenu le second plus important chiffre d’affaires du monde entier : 9,7 milliards de dollars. Cela en fait l’un des best-sellers au niveau mondial. Il a pourtant profité d’un solide soutien financier, grâce entre autres à son statut d’orphelin.
Revlimid n’est pas seulement basé sur une molécule existante, ce qui a réduit les frais de recherche et de développement. Une grande partie de cette recherche a été universitaire et a donc été partiellement financée par les deniers publics. Ce à quoi il faut ajouter que le médicament, de par son statut d’orphelin, profite d’une kyrielle de réductions et avantages fiscaux, que ce soit en Belgique ou à l’étranger. Il s’est en outre vu attribuer trois fois une période d’exclusivité commerciale, une pour chaque maladie orpheline pour laquelle il a été enregistré.
Plus de patients, donc plus de gains
Les indications de traitement ont été élargies à cinq reprises. De quoi augmenter proportionnellement le nombre de patients, ainsi que la pression sur notre assurance maladie. Malgré une diminution de prix de 13 % au fil des ans, les frais de remboursement de l’INAMI ont augmenté de 7,4 millions d’€ en 2008 jusqu’à 74,8 millions d’€ en 2018. Le Revlimid fait dès lors partie des dix plus importantes dépenses de l’INAMI pour des médicaments délivrés par le pharmacien hospitalier.
Il va sans dire que ce blockbuster n’a nullement besoin d’être stimulé aux frais de la société.
Everolimus : nouvelle indication, nouveau statut
Everolimus a fait son entrée sur le marché en 2004 afin de combattre les réactions de rejet après une transplantation d’organes. Il est remboursé dans notre pays sous le nom de Certican depuis 2005. Novartis a commercialisé Everolimus en 2009 en tant que médicament orphelin baptisé Afinitor pour le carcinome rénal avancé. Il est remboursé dans notre pays depuis 2010. Ce changement de nom était un impératif : seul un autre patronyme permettait d’obtenir le statut d’orphelin pour le médicament.
Un traitement au Certican coûtait après obtention du remboursement environ 400 € par mois (1,5 mg/jour). Un traitement avec ce même médicament, cette fois sous l’appellation Afinitor, coûtait par contre presque 3 800 € par mois (10 mg/jour). De quoi multiplier les coûts par patient pour un mois de traitement par 9,5. Une augmentation de prix sans commune mesure avec les frais réels.
Afinitor a perdu son statut d’orphelin au bout de quelques années. Novartis a aussi enregistré le médicament pour d’autres cancers qui n’étaient pas tous rares. En 2011, la firme a commercialisé la molécule pour une autre maladie rare (la sclérose tubéreuse de Bourneville) sous un troisième nom : Votubia. Le changement de nom était une fois de plus nécessaire pour obtenir le statut d’orphelin, et pour négocier une augmentation de prix. Le coût d’un traitement (par mois, mêmes doses du même principe actif) était de 20 % supérieur à celui d’Afinitor lors de l’octroi du remboursement en 2016.
Trois noms commerciaux différents pour huit indications de traitement
La molécule est depuis lors vendue sous trois noms de marque différents pour huit indications de traitement différentes. La firme brasse plus d'un milliard de chiffre d’affaires rien qu’avec cette seule molécule, dont les indications ne cessent de s'étendre. Les prix demeurent élevés, alors que les coûts pour la recherche et le développement sont limités en cas de repurposing (l’introduction d’une molécule existante pour de nouvelles indications de traitement).
En 2019, Certican rapportait un chiffre d’affaires mondial de 485 millions de dollars, tandis qu’à eux deux, Afinitor et Votubia totalisaient plus de 1,5 milliard de dollars.
Il va sans dire que ce blockbuster n’a nullement besoin d’être stimulé aux frais de la société.
Les demandes de Testachats concernant ces médicaments
Il faut renforcer les règles
Il y a manifestement beaucoup d’argent à gagner avec les médicaments orphelins. On trouvait en 2018 dans le top 200 des médicaments au plus gros chiffre d’affaires une trentaine de médicaments ayant ou ayant eu dans le passé un statut orphelin. Une vingtaine d’entre eux sont des médicaments à grand succès, qui rapportent plus d’un milliard de dollars par an. Nombre de ces médicaments sont largement rentables et peuvent se passer de ce coup de pouce.
Or, non seulement beaucoup de ces médicaments sont souvent le seul traitement de maladies graves, mais encore les firmes gardent le secret sur leurs coûts réels. Cette position de faiblesse de nos autorités dans les négociations entraîne encore trop souvent des prix exorbitants.
En 2010, les dépenses de l'INAMI en médicaments orphelins se sont élevées à 198 millions d'euros. Dix ans plus tard, nous sommes montés à un montant estimé à environ 513 millions d'euros, soit presque le triple. En 2010, cela représentait près de 5% des dépenses totales en médicaments, et en 2019, on estime ce montant à environ 10%.
Nouvelle inégalité
Non seulement le statut de médicament orphelin coûte cher à la société, mais il a aussi créé de nouvelles inégalités. Pas moins de 40 % des médicaments orphelins sont destinés au traitement de certains cancers (rares), une niche dont la rentabilité est bien établie.
Alors que plusieurs médicaments ont été développés pour certaines maladies et certains groupes-cibles, rien ou quasi rien n’a été fait pour d’autres. Selon une récente analyse, la recherche sur les maladies rares se concentre encore sur les maladies touchant les adultes et celles qui apparaissent relativement souvent. La recherche sur les enfants est en effet plus difficile et plus coûteuse. Et les médicaments pour un plus grand groupe-cible rapportent plus d’argent.
Comme ce sont les firmes qui décident des médicaments qu’elles développent et commercialisent, et que ce sont les gains potentiels qui les guident, l’actuel modèle ne répond que trop peu à des besoins de santé publique. On estime que 95 % des maladies rares n’avaient encore aucune option de traitement en 2018.
Nos revendications
Le règlement européen qui a introduit les incitants doit être modifié de toute urgence. Nous demandons depuis longtemps que le statut, ses conditions et ses avantages soient révisés. L'Europe y travaille. Nous aimerions que plusieurs adaptations soient faites, tant au niveau européen que national :
- La condition pour obtenir le statut de médicament orphelin selon laquelle 5 personnes sur 10.000 doivent souffrir de la maladie est totalement arbitraire et devrait être revue. Il existe actuellement de nombreux médicaments orphelins qui profitent des incitants, mais qui exigent des prix très élevés et réalisent donc d'énormes profits.
- En tant que société, nous ne pouvons pas nous permettre de dépenser des ressources supplémentaires pour des incitants qui ne sont souvent même pas nécessaires pour rentabiliser les médicaments orphelins.
Par conséquent :
- le manque de rentabilité doit être primordial dans l'attribution du statut d'orphelin. Ce n'est pas le cas maintenant;
- un mécanisme de protection dans lequel l'exclusivité du marché peut être limitée si les marges bénéficiaires ne sont pas (plus) raisonnables doit être mis en place.
- Un certain nombre d'exigences que nous avons formulées pour les médicaments «ordinaires» s'appliquent également ici, par exemple une fixation de prix équitable.
- Des mesures sont nécessaires pour stimuler le développement de génériques et de bio-similaires moins chers pour les médicaments orphelins.
Exclusivité membres
Ce contenu est exclusivement réservé à nos membres.
